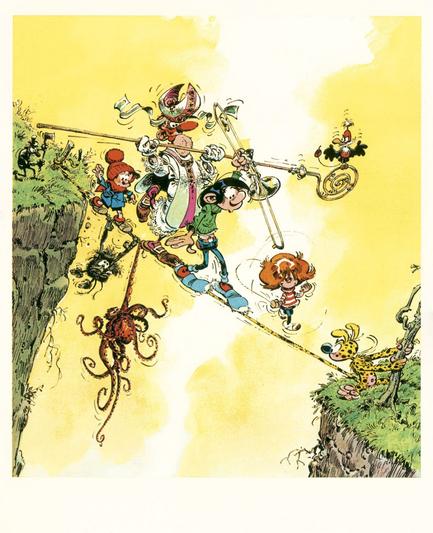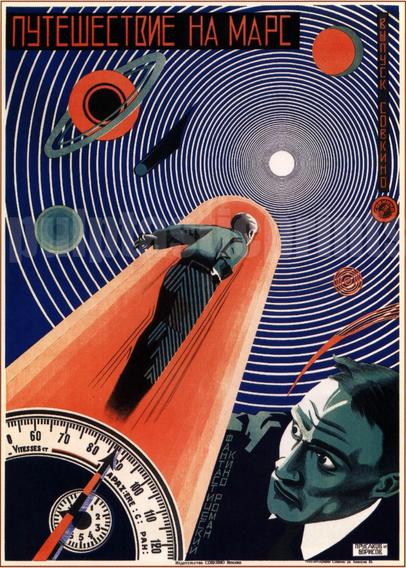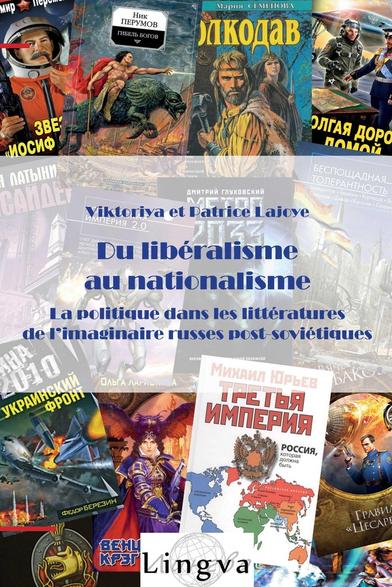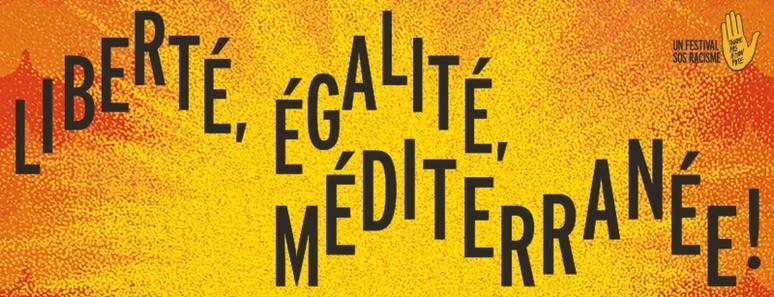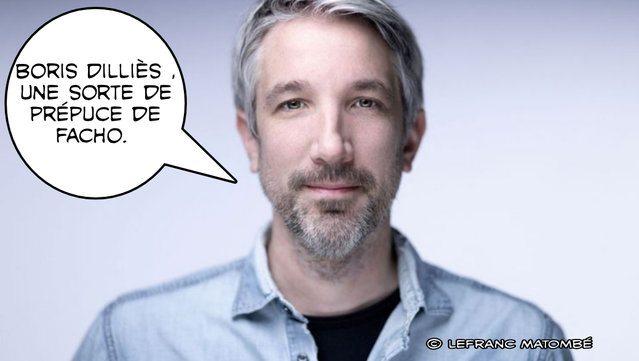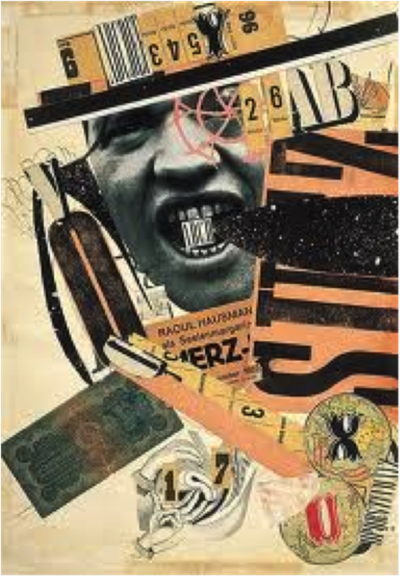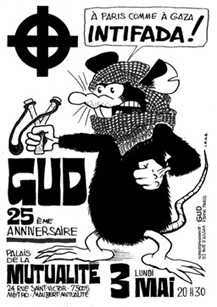📢NPArevolut°R📢 Philharmonie de Paris : le double discours de l’État français: Que n’ont pas fait les quatre militants qui ont craqué un fumigène pour protester contre le génocide lors d’une représentation de… 📢NPA-R #PhilharmonieDeParis #ArtEtPolitique #Génocide #OrchestreNationalIsraël
Philharmonie de Paris : le dou...
#artetpolitique
[Festival contre #Marchandisation - Lyon déc]
🎯 #Associations, #artistes chercheur·ses, citoyen·nes, élu·es : et si on faisait nos cartons ensemble ?
Le festival Carton Plein, c’est 3 jours pour penser autrement la chose publique, à l’intersection de la culture, du militantisme, de la recherche et de la société civile.
#Débats, #formations, #performances artistiques
📍 Lyon / Villeurbanne
📆 1, 2 et 3 décembre 2025
🎟 gratuit sur inscription
👉🏽 www.coincoinprod.org/cartonplein
@coincoinproductions
@CAC
@Lemouvementasso
#CartonPlein #LibertéDeCréer #Culture #ÉconomieSolidaire #ArtEtPolitique #LibertesAssociatives #MarchandisationAssociative
La Critique sociale chez Franquin. L’exemple de Gaston Lagaffe
Première parution : Stéphane François, « La critique sociale chez Franquin. L’exemple de Gaston Lagaffe« , Emmanuel Cherrier, Pierre-Alexis Delhaye, Serge Deruette et Stéphane François, Neuvième art, pouvoirs et politique, 2024, Valenciennes, Presses universitaires de Valenciennes, pp. 213-224.
André Franquin (1924-1997) est connu pour être une figure importante de la bande dessinée franco-belge : Spirou et Fantasio, le Marsupilami, Gaston Lagaffe sont quelques-unes de ses réussites. Si ses Idées noires[1], parues en 1977, sont des critiques acerbes des travers de notre société à la fois hypermoderne et conservatrice, nous en trouvons d’autres, plus discrètes, dans l’ensemble de son œuvre. Ainsi, les dictatures militaires sont tournées en dérision dès 1954 dans Le dictateur et le champignon[2], une aventure de Spirou, de même que la publicité et le consumérisme lorsque Zorglub utilise son armée de zombies pour écrire un slogan publicitaire (à l’envers) sur la Lune (Z comme Zorglub)[3], toujours chez Spirou…
Ces critiques sont aussi très présentes dans la série des Gaston Lagaffe, créé en 1957[4], et dont la dernière planche éditée remonte à 1991[5], avec une nette teneur écologiste et, déjà, décroissante. Les « gaffes » de Gaston démontent par l’absurde la bureaucratie, sans pour autant être un émule de Cornélius Castoriadis[6], mais anticipant d’une certaine façon les constats de l’anthropologue anarchiste David Graeber[7]. N’oublions pas que Gaston est un garçon de bureau, plus précisément un employé de la rédaction, chargé de trier le courrier des lecteurs adressé au Journal de Spirou, fonction tertiaire qui se développe beaucoup dans la société de l’après-guerre. Gaston délaisse cette fonction, qu’il déteste (sa « principale corvée », selon lui), laissant le courrier s’accumuler pendant des semaines, voire des mois, devenant un immense tas, qu’il cherche à cacher. Cela permet à André Franquin de laisser libre cours à son humour poétique et absurde.
Nous proposons de les étudier ici[8] et de montrer que les futurs thèmes des Idées noires (l’écologie, le rejet de la chasse, le refus du consumérisme, la critique de l’institution militaire, etc.) sont déjà présents[9], certes de façon moins caustique et plus discrète, mais avec la même efficacité comique[10]. André Franquin profite de la liberté accordée par le personnage de Gaston, pour faire passer une critique sociale[11]. Tous les gags de Gaston (950 ![12]) ne sont pas de portée politique. Nous en avons sélectionné quelques-uns ici, parmi les plus représentatifs, tirés principalement des derniers albums.
La naissance de Gaston Lagaffe
Le personnage de Gaston apparaît dans le Journal de Spirou du 28 février 1957, en costume et nœud papillon, puis, deux semaines plus tard dans ce qui sera sa tenue : jean noir, pull-over vert et espadrilles. Ses débuts sont connus. Interrogé par Spirou, dans un dialogue mémorable, très surréaliste d’une certaine façon[13], Gaston a été recruté par une personne dont il ne se rappelle pas le nom, mais il demeure persuadé qu’il a été embauché pour un travail de héros de bande dessinée. Il est dans un premier temps un « héros sans emploi », bête et maladroit, gaffeur, avec parfois des réactions infantiles et un langage au vocabulaire limité[14]. Il boude d’ailleurs fréquemment dans les premiers volumes. Il deviendra rapidement un anti-héros sympathique, à la bonne humeur contagieuse[15], paresseux et gaffeur, inscrit dans la contre-culture[16].
La psychologie de Gaston évolue et se complexifie lorsque Franquin abandonne les personnages de Spirou et Fantasio. En effet, il éprouve de plus en plus de lassitude à animer Spirou, dont il n’est pas le créateur, et auquel il ne peut pas faire faire ce qu’il souhaite car le héros-groom appartient légalement aux éditions Dupuis, Jean Dupuis étant l’un des créateurs de Spirou[17]. Cela dit, l’aspect loufoque du monde de Franquin y est déjà présent avec le Marsupilami, animal curieux et gaffeur (voire un tantinet anarchiste), imaginé en 1952[18].
Gaston devient alors moins fainéant et plus intelligent, devenant un inventeur très créatif. La finalité de ces inventions est de faciliter son travail au bureau. De même, son environnement social s’enrichira : au fil des gags et des albums, nous voyons Gaston entourés d’amis, personnages secondaires, mais récurrents. Il s’agit de Jules-de-chez-Smith-en-face, Bertrand Labévue, Gustave, Manu, et son ami dessinateur Yves Lebrac, mais aussi de quelques ennemis : Aimé de Mesmaeker, l’industriel ou le brigadier-chef Longtarin.
Pour créer Gaston, il semblerait que Franquin se soit inspiré de la contre-culture, en particulier des beatniks – pour les premières planches-, et par les hippies -pour les dernières-. Nous retrouvons effectivement des similitudes avec la Beat Generation -voire les stéréotypes de la culture « beat » : le pacifisme, le refus de travailler, le non-conformisme ou l’excentricité, la vie de bohème ; ainsi que ses caractéristiques vestimentaires : abandon de la cravate, cheveux non peignés ou longs, béret (parfois), sandales (remplacées ici par les espadrilles), duffle-coat, blues jeans et cols roulés[19]. Tous ces éléments se retrouvent chez Gaston, mais cette référence reste superficielle : Franquin ne reprend aucun point de la culture politique « Beat », plutôt de droite : Burroughs était un conservateur, Kerouac un homophobe… En revanche, comme la Beat generation, Gaston aime passionnément la musique :
« Avant d’inventer le gaffophone, Gaston Lagaffe s’essaye à de nombreux instruments : guitare, trombone, bombardon, scie, violon tzigane, klaxophone, guitare émettrice, tuba basse, avec une certaine prédilection pour le rock, et le jazz, des musiques encore marginales, à l’orée des années 60, qui de préférence font du bruit et dérangent l’ordre établi »[20].
Dans les premières planches, nous le voyons aussi apprécier les prémisses du rock ainsi que les yéyés[21], l’ancêtre de la pop française[22]. Il s’agissait donc pour Franquin de créer un marginal sympathique, mais en phase avec son époque. Cependant, l’évolution hippie de Gaston Lagaffe semble plus profonde, plus sincère, moins superficielle, avec un discours construit. De même, les tenues des autres personnages (Lebrac, Mademoiselle Jeanne, etc.) de l’univers de Gaston évoluent de façon similaire[23], sans oublier l’importance donnée au graphisme et à l’esthétisme psychédélique[24], sans parler de la musique du même nom, avec le groupe Moon Module Mecs[25], fondé avec Jules et Bertrand Labévue.
L’âge d’or de la bande dessinée Gaston Lagaffe peut donc être borné chronologiquement entre 1965 et 1974. Depuis 1965, un album de Gaston sort chaque année, et cela jusqu’en 1974. L’album n°12, Le Gang des gaffeurs, paru en 1974, est le dernier à être publié de manière régulière. Par la suite, Franquin enchaîne différents projets, de plus en plus ouvertement contestataires, annonçant les Idées noires, publiées en 1977.
Cette période voit à la fois l’évolution psychologique du personnage qui s’étoffe, devenant un rêveur, et l’apparition de gags plus complexes. Elle correspond aussi au moment où Franquin abandonne son personnage principal, Spirou en 1967, pour se consacrer uniquement au « héros sans emploi », qui devient alors un « gaffeur professionnel ». Au contraire de Spirou, Franquin est totalement libre de faire évoluer Gaston et il s’enthousiasme pour ce personnage. Lorsqu’il cède la série Spirou et Fantasio à Fournier en 1969[26], en pleine agitation contre-culturelle, Fantasio cesse d’apparaître régulièrement dans les aventures de Gaston. Franquin ne souhaite pas que deux versions du même personnage par deux dessinateurs différents coexistent dans le journal de Spirou. Pour le remplacer, il met alors un personnage apparu depuis longtemps dans la série mais jusqu’ici confiné à un second rôle : Léon Prunelle.
La critique sociale de Franquin peut s’avérer très violente, y compris dans Gaston Lagaffe. Dans le gag 827[27], il n’hésite pas à dessiner un avion miniature allemand de la Seconde Guerre mondiale, monté par Gaston, qui bombarde le bureau de Prunelle, le rédacteur en chef du Journal de Spirou. À la fin du gag, Franquin, via la voix de Gaston, n’hésite pas à énoncer son message (à l’équipe de Spirou ? à la direction de Dupuis, aux lecteurs ? tous à la fois ?) : « Binquoi ?! Ceux qui fourrent ces bidules guerriers plein leurs illustrés, faut bien de temps en temps qu’on leur rappelle à quoi servent ces merveilles… ». En faisant cela, Franquin montre son hostilité vis-à-vis de la rubrique « Mister Kit » du Journal, consacrée aux maquettes, laquelle, sous la pression des lecteurs, présente le plus souvent des engins militaires allemands.
Derrière le hippie bon enfant, le dynamiteur des Trente Glorieuses
Comment Dupuis, un éditeur catholique, au discours plutôt conservateur, a pu laisser une telle marge de manœuvre au dessinateur ? Le journaliste Frédéric Potet nous donne une piste de réflexion : « Le brider l’aurait probablement poussé à aller exercer son talent ailleurs. Dupuis savait aussi que le dessinateur ne dépasserait jamais les bornes autorisées, à l’image de son mentor Yvan Delporte, un écolo anarchiste à la barbe fleurie qui dirigea la rédaction de l’hebdomadaire pendant douze ans.[28] »
Gaston Lagaffe s’inscrit parfaitement dans les Trente Glorieuses, avec une mélancolie grandissante dans les années 1970, en lien avec l’évolution de Franquin, son épuisement et la dépression qui en découle[29]. Si les premiers volumes insistent sur la maladresse et la bêtise de Gaston, les autres montre un personnage moins naïf et plus engagé, sabotant systématiquement les valeurs du travail en semant la pagaille dans la rédaction, mettant en avant un mode de vie décroissant[30] et faisant l’éloge de la lenteur[31], largement avant que ces conceptions de la société ne deviennent à la mode. Cet engagement n’est pas idéologique : il n’y a aucun discours politique explicite dans les différents volumes de Gaston Lagaffe, car il s’agit d’une publication pour enfants. Ces discours sont à chercher dans Les Idées noires, publiées initialement dans le Trombone illustré (un supplément de Spirou) puis dans Fluide glacial. Pour autant, quelques gags sont ouvertement politiques, mais ils se trouvent dans le dernier volume publié régulièrement, La saga des gaffes, 1982 : dans le 866[32], il participe à une manifestation contre les armements, et dans le 870[33] à une manifestation écologiste. Pour autant, Franquin rejette l’idée d’être un auteur politique[34]. Néanmoins, nous voyons en filigrane, et/ou de manière implicite, une critique du consumérisme, avec une ambiguïté certaine toutefois, Gaston étant parfois un consommateur compulsif (de produits alimentaires bon marché : des conserves de fruits au sirop, des sardines ou des saucisses, etc.) ; une critique virulente de la chasse ; de l’armée ; voire, plus généralement, de la vitesse (pensons à sa fiat antédiluvienne[35]), anticipant le mouvement « slow »[36]… En ce sens, Franquin est en phase avec son époque, qui voit la montée d’une contestation radicale des modèles dominants, tel le culte de la réussite et de la rentabilité, le conformisme social et le patriotisme. A contrario, de nouvelles valeurs émergent : le féminisme, le pacifisme ou l’écologie, visibles dans les dernières bandes dessinées de Gaston Lagaffe.
Le Centre Georges Pompidou ne s’y est pas trompé, en rendant hommage au gaffeur et à ses valeurs « doucement subversives » en 2016[37]. Indifférent au productivisme et à la l’économie -lui qui prend son temps dans une rédaction qui court[38]-, Gaston passe la plus grande partie de son temps à essayer d’éviter de travailler. D’une certaine façon, nous pouvons voir dans cette série un éloge de la paresse, pour paraphraser Paul Lafargue[39], Franquin y critiquant comme l’a fait remarquer le journaliste Frédéric Potet, l’amour absurde du travail[40]. L’universitaire Amaury Grimand y voit même une nouvelle forme de management[41].
En effet, si dans les premiers volumes Gaston est explicitement un fainéant, par la suite, on le voit actif. Il invente une foule de choses, très poétiques, mais sans possibilité d’applications concrètes. Pensons au gaffophone, à la tondeuse pour éviter de couper les pâquerettes[42] ou à la machine à fabriquer des avions en papier… Nous pourrions multiplier les exemples presque à l’infini. Bref, Gaston est très prolifique en ce qui concerne le bricolage, les inventions, la chimie, les innovations en tous genres, les objets détournés de leur usage normal… Dès 1982, Lewis Caillat a pu parler, à ce sujet, de « dispositifs d’antiproduction ou de production déviantes », soulignant son « énorme potentiel d’énergie improductive »[43]… De son côté, Bruno Latour le voit en « philosophe des techniques », pour reprendre le titre de l’un de ses textes[44]. En mars et avril 2018, la Cité des sciences et de l’industrie rend hommage à cette productivité et présente une exposition de sept inventions de Gaston Lagaffe[45].
Gaston n’est donc pas un fainéant sans qualité, mais plutôt une sorte d’innovateur autodidacte et farfelu, parfois génial[46], ne demandant qu’à contribuer à la société, alors que son employeur ne sait malheureusement pas l’utiliser. Ses inventions sont une preuve à la fois de sa créativité et de sa liberté : il ne restreint pas son imagination. Par ailleurs, celles-ci ne sont jamais dans le registre de la science ou de l’application concrète. Elles restent dans une logique poétique ou de farce, parfois même de nature dadaïste[47]. Elles relèvent d’un caractère enfantin, rêveur. Cette attitude s’affranchit ouvertement des normes et des contraintes productivistes, consommatrices, des Trente Glorieuses.
En ce sens, Gaston Lagaffe incarne bien l’esprit contestataire des années 1960, période faste pour le personnage. Il est rétif aux ordres et à l’autorité, mais d’une façon très intéressante : il ne les conteste pas, il n’y oppose pas frontalement. Simplement, il n’obéit pas et n’en fait qu’à sa tête, tournant en dérision les valeurs de hiérarchisation sociale de l’époque. Il rêve d’autre chose, s’évadant de la rédaction. Naufragé avec Mademoiselle Jeanne, échoué avec elle sur une île déserte paradisiaque, renouant avec l’idée du « bon sauvage » des utopistes du XVIIIe siècle[48], les deux se voient comme des « Robinsons de l’amour ». Malheureusement, Prunelle, cherchant les contrats ou amenant un sac de courrier en retard, le fait brutalement revenir à la réalité[49].
Les premiers volumes sont aussi, d’une certaine façon, pré-écologiques, Gaston étant proche de la nature et s’entourant d’animaux, plus ou moins sauvages et plus ou moins de compagnie : une mouette rieuse (au caractère épouvantable), un hérisson (Kissifrott), une souris grise (baptisée « Cheese »), des souris blanches, un poisson rouge (« Bubulle »), une tortue (« Achille ») et même des escargots, sans oublier évidemment le chat (dingue), inspiré de celui de Franquin… Au-delà de ce bestiaire récurrent, les animaux sont très présents dans les planches de Franquin, y compris les plus exotiques : éléphant, lion, perroquet, girafe, etc. Gaston est un garçon sensible, adorant les animaux et se portant régulièrement à leur secours. Il lui arrive ainsi de recueillir des chatons abandonnés ou de sauver un homard dans un restaurant, qui devait être ébouillanté. Comme Franquin, Gaston est un fervent défenseur de la cause animale, proche des écologistes[50]. Ainsi, le gag 839 met en scène la mouette de Gaston, qui réagit violemment à un reportage télévisé sur une marée noire[51].
L’intérêt de Franquin pour l’écologie se voit également autrement, en mobilisant, par exemple, le tacot, lent, de Gaston se faisant souffler par un coupé sportif[52], ou dans les noms de communes sur les panneaux d’autoroutes. En faisant attention, nous pouvons lire « Bétonville » ou « Moches-les-Grands-Clapiers »[53] ou d’autres noms farfelus, mais explicite quant aux idées du dessinateur sur l’essor des banlieues, dans certaines planches. Franquin évolue toujours aux marges du discours politique et de la critique sociale, sans jamais franchir la ligne blanche[54]. Malgré tout, et fort logiquement, Gaston, comme Franquin, déteste les chasseurs[55].
Comme le fait remarquer Erwin Dejasse,
« Très tôt, la fascination pour le progrès technologique exprime ses limites. Singulièrement quand ce “progrès” n’a d’autre but que la destruction de ses semblables. Dans son atelier, Franquin dessine en écoutant les chaines d’information françaises sur sa radio à ondes courtes. L’armée étasunienne est empêtrée dans le bourbier vietnamien et dans toutes les capitales du monde, on assiste à d’importantes manifestations contre ce conflit absurde. Jamais peut-être une guerre n’avait suscité pareil rejet. […] Dans le même temps, s’exprime dans la jeune génération une aspiration vers la liberté d’une intensité inédite. Demeuré à la marge de l’ébullition contre-culturelle, Franquin a toujours réfuté l’idée de véhiculer un quelconque message dans ses créations.[56] »
Le dessinateur le reconnait d’ailleurs sans peine : « Je ne suis pas un dessinateur “politique”, tu comprends ? J’ai mes opinions, elles sont plutôt à gauche, mais je ne les ai jamais étalées dans mes bandes dessinées. Ce n’est pas mon boulot…[57] » Néanmoins, il trouvait dans l’humour un moyen de dénoncer ce qui l’horripilait, des injustices du monde à la vacuité de l’existence…
Gaston ou Franquin ?
S’il n’y a pas officiellement de discours politique chez Franquin, celui-ci donne néanmoins souvent son avis/ses positions (par exemple dans certains volumes des aventures de Spirou, comme nous l’avons dit précédemment). Sa liberté avec Gaston lui permet de s’exprimer plus ouvertement. Franquin a d’ailleurs utilisé sa notoriété, et celle de Gaston, pour soutenir des causes, qu’il jugeait importantes : Amnesty International, Greenpeace… ou en créant un autocollant pour l’Unicef (« l’Unicef sauve vraiment des enfants », 1985).
Ainsi, en 1978, la section belge d’Amnesty International commande une affiche à Franquin, qui accepte. On y voit Gaston sommeiller comme à son habitude sur son bureau et cauchemarder qu’on le torture de différentes façons (selon des pratiques alors utilisées par les dictatures ou régimes totalitaires de l’époque[58]), avant de se faire envoyer dans un camp d’internement[59]. Franquin est moins sombre pour la campagne pour Greenpeace. Un équipage de baleinier est mis en échec dans le gag où Greenpeace engage Gaston pour éloigner les baleines à l’aide de son gaffophone[60], l’idée étant que les baleines ayant l’oreille musicale selon les militants de Greenpeace, elles fuiront devant les sons de l’instrument. Ce navire baleinier se retrouve plus loin dans le même album, cette fois-ci sur deux pages[61], Gaston le bombardant, oniriquement, à l’aide de projectiles dont la charge est composée d’une super-colle. Ce militantisme en faveur des baleines reflète l’opinion de Franquin, qui trouvait les baleines magnifiques et ne supportait pas qu’on les massacre. Greenpeace utilise Gaston pour mettre en lumière ses propres actions de sauvegarde. Il est d’ailleurs particulièrement intéressant de noter que Franquin mentionne explicitement Greenpeace, là où d’autres auraient choisi une association fictive.
Lors de la série de gags sur les parcmètres, nous voyons Gaston manifester avec ses amis pour empêcher l’agent Longtarin d’arracher le lierre qu’ils ont fait pousser sur une de ces machines, avec une banderole portant le slogan « Le lierre c’est comme l’amour : je meurs où je m’attache »[62]. Néanmoins, Gaston n’est pas un rural : si plusieurs gags le montrent à la campagne, notamment dans la ferme d’un agriculteur appelé Gustave, personnage récurrent de la bande dessinée, il est rétif aux travaux agricoles[63] et, profondément urbain, il cherche à améliorer la vie avec ses inventions[64].
Comme Franquin encore, Gaston déteste les représentants de l’État[65], ainsi que l’institution militaire, qu’il tourne systématiquement en dérision[66]. Dans le gag 891, paru en 1982, dans un contexte de tensions géopolitiques entre l’URSS de Leonid Brejnev et les États-Unis de Ronald Reagan, sur fond de crise des « euromissiles », c’est-à-dire du déploiement de missiles nucléaires en Europe (Pershing d’un côté, SS 20 de l’autre)[67], Gaston/Franquin est plus explicite. Dans un échange avec Prunelle, Gaston exprime sa pensée « Hé ! si tous les généraux et amiraux du monde, quelles que soient les couleurs ou les étoiles, avaient chacun un chat sur les genoux, hébin moi, je me sentirais vachement mieux, moi »[68]. Pour autant, André Franquin refuse d’être considéré comme un antimilitariste ou comme un anarchiste[69].
De fait, les idées politiques de Franquin se voient également dans la série de gags (plus d’une quinzaine) appelée génériquement la « guerre des parcmètres ». Ceux-ci venaient de faire leur apparition dans les villes afin de réguler le stationnement automobile. Ces gags apparaissent à la fin des années 1970[70], et donnent une nouvelle intensité aux sketchs avec l’agent Longtarin, bête noire de Gaston[71] (et réciproquement visiblement), Franquin va y « trouver à la fois un accessoire récurrent pour une série de gags et un symbole de sa haine de l’autorité et des uniformes »[72]. Surtout, Franquin avait en horreur les parcmètres. En effet, il ne supportait pas devoir payer pour se garer. Le journal Spirou le soutiendra. Son numéro 2169, du 8 novembre 1979, annonce la mobilisation générale, tandis que des autocollants « T’as payé pour rouler, maintenant paie pour t’arrêter… » sont offerts au lecteur. Le journal organise même un concours où les lecteurs sont invités à photographier des parcmètres déguisés en œufs de Pâques. Un parcmètre est promis en cadeau à l’auteur de la photo la plus drôle. La campagne anti-parcmètres dure jusqu’au numéro 2177. Entre les deux numéros, les couvertures de Spirou représentent un gag de Gaston aux prises avec ces appareils.
Jugé marginal par Charles Dupuis et par Franquin lui-même dès ses premiers pas[73], et il était assurément un marginal -un beatnik puis un hippie, Gaston a remis en question les notions même de hiérarchie, de contrainte, voire la société productiviste des Trente Glorieuses. Il le fit de manière très diffuse dans un premier temps et à compter du milieu des années 1960, d’une façon de plus en plus explicite. En 1968, alors que la jeunesse criait « Il est interdit d’interdire ! », Gaston continuait de résister aux militaires et aux patrons (M. de Mesmaeker et ses contrats jamais signés) ; dynamitant au passage les valeurs bourgeoises. Au point que les éditions Dupuis reçurent, quelques jours avant les émeutes parisiennes, un courrier des autorités leur demandant de contenir les élans libertaires et contestataires de Franquin[74].
Pour autant, Gaston n’est pas hors de la société. Nous sommes ici au cœur du paradoxe de l’attitude de Gaston : d’un côté, il remet en cause la société des Trente Glorieuses, dynamitant les valeurs du travail, promouvant un pacifisme et un antimilitarisme de plus en plus assumé ; de l’autre il passe son temps à chercher à améliorer sa fainéantise et, au-delà de son cas, la société. En effet, Gaston prône une autre société, structurée sur le loisir et la paresse. De fait, il apparaît comme un anarchiste très individualiste, sans pour autant sombrer dans un discours à la Stirner[75] ou cynique à la Corto Maltese – personnage de bande dessinée créé par l’Italien Hugo Pratt dont les lecteurs francophones prennent connaissance à la même époque (par ailleurs étudié par Thomas Richard dans le présent ouvrage). Gaston reste un rêveur pacifique et non-violent, un peu enfantin. C’est tout l’intérêt d’une étude de ce personnage devenu culte : il est à la fois hors et dans la société[76]. Il vit une modernité alternative, sans discours politique et sans imposer son point de vue. Il est devenu « le porte-parole d’une pensée anticonformiste qui frôle l’anarchie » selon le mot de Numa Sadoul[77].
Comme nous l’avons vu ici, derrière Gaston il y a André Franquin. L’un et l’autre ne faisaient plus qu’un depuis longtemps, et à mesure que le dessinateur s’horrifiait devant les scandales humanitaires et écologiques qui sévissaient dans les années 1970, Gaston hurlait sa colère, son besoin de paix et de rêve. Il devenait plus mélancolique, et surtout plus mature (plus adulte ?). Tandis que la société restait sourde à ses suppliques, Franquin se laissait aller à un pessimisme de plus en plus assumé, et Gaston devenait grave, de plus en plus grave. Les petits monstres de Franquin[78] devenaient des Idées noires, un ensemble de gags en noir et blanc, au questionnement existentiel et écologique, traitant de la mort et de la stupidité humaine. Idées Noires est assurément sa bande dessinée la plus intime et la plus torturée. Il suivait en cela l’évolution des sociétés occidentales. L’ère de l’insouciance était finie, celle de la crise commençait[79]. Mais cela est une autre histoire…
Notes
[1] André Franquin, Idées Noires, Paris, Fluide glacial, 1977.
[2] André Franquin, Le dictateur et le champignon, Charleroi, Dupuis, 1956. Publication initiale en 1954 dans le Journal de Spirou, avant d’être édité en album.
[3] André Franquin, Z comme Zorglub, Charleroi, Dupuis, 1961. Prépublication en feuilleton en 1960 dans le Journal de Spirou.
[4] 28 février 1957, Spirou, no 985. Première apparition de Gaston Lagaffe.
[5] 25 juin 1991, Spirou no 2776, dernière planche inédite de Gaston.
[6] Nicolas Poirier, « Quel projet politique contre la domination bureaucratique ? Castoriadis et Lefort à Socialisme ou Barbarie (1949-1958) », Revue du MAUSS, vol. 38, no2, 2011, pp. 185-196 ; Christophe Premat, « L’analyse du phénomène bureaucratique chez Castoriadis », Tracés. Revue de Sciences humaines [En ligne], 1 | 2002, mis en ligne le 11 mai 2009, consulté le 13 octobre 2022. URL : http://journals.openedition.org/traces/4131.
[7] David Graeber, Bureaucratie (trad. fr. de The Utopia of Rules), Les liens qui libèrent, 2015.
[8] Pour ce texte, nous utilisons la collection complète et originale de Gaston, c’est-à-dire sans tenir compte des rééditions ou réorganisations postérieures, qui se compose de la façon suivante : 1/Les six albums de la première série, du no 0 au no 4 (1960-1967) ; 2/les albums nos 6 à 15 de la deuxième série (1968-1996) ; le tome 19 inédit, paru aux éditions Marsu Productions après le décès de Franquin. En outre, l’ordre de publication est chronologiquement illogique : 0, 2, 3, 4, 1, 5, 6, 7, 8, R1, 9, R2, 10, R3, 11, R4, 12, 13, 14, R0, R5, 15. Cela est dû à la non-réédition des premiers albums de la série, ces derniers étant publiés initialement au format à l’italienne. Cette politique éditoriale a amené la série à ne pas avoir de no 5 durant 20 ans, donnant ainsi naissance à la légende de l’album fantôme. En 1997, les planches sont triées chronologiquement et publiées dans 18 albums (plus un dix-neuvième sorti plus tard et inédit dans l’édition originale), devenant l’édition définitive. Du fait de ces différentes éditions et des nouveaux découpages qui en ont découlé, nous nous référerons aux numéros des gags et non à une référence paginale, qui change d’une édition à l’autre. Nous utiliserons également son livre d’entretien avec Numa Sadoul, Et Franquin créa la gaffe. Entretiens avec André Franquin, Schlirf books, 1986, réédité en novembre 2022 chez Glénat, avec un format différent.
[9] Il y a néanmoins un thème absent : l’anticléricalisme. Dupuis étant un éditeur catholique, il était impossible pour Franquin de l’exprimer chez Gaston. En revanche, il sera très présent dans les Idées noires.
[10] Si les idées politiques de Gaston n’ont été que peu étudiées, les ressorts comiques de cette bande dessinée ont été l’objet d’études universitaires. Nous pouvons citer, comme exemples : Richard Guez, Analyse sémiotique de bandes dessinées : de la construction du sens dans deux aventures de « Gaston Lagaffe », université de Toulouse 2, soutenue en 1992 ; Lahcen Hasbi, Les figures de style dans la sémiologie et comme source de comique dans la bande dessinée d’expression française (Gaston Lagaffe), université de Paris 5, 1995 ; Henri Garric, « L’engendrement du gag dans Gaston Lagaffe de Franquin », in Henri Garric (dir.), L’Engendrement des images en bande dessinée, Presses Universitaires François Rabelais, 2014, pp.43-54, 2014, etc.
[11] Le concept de « critique sociale » peut être défini comme l’acte de se rebeller, notamment d’un point de vue rhétorique, d’un individu ou d’un groupe social. Ces critiques portent sur les problèmes sociaux de la société contemporaine. Caroline Guibet Lafaye, « Les fondements de la critique sociale : normes alternatives et raisonnements hypothétiques », Metabasis, Mimesis edizioni, 2014, IX (n° 18), 16 p. ffhal-01070787
[12] L’article de Frédéric Potet, publié en 2016 dans Le Monde annonce un nombre de 950 gags. Frédéric Potet, « Gaston Lagaffe, icône antimilitariste, antiflics et écolo avant l’heure », Le Monde, 26 décembre 2016, https://www.lemonde.fr/m-moyen-format/article/2016/12/23/franquin-un-dessinateur-antimilitariste-antiflics-et-ecolo-avant-l-heure_5053494_4497271.html. Consulté le 09/10/2022.
[13] Le dialogue est reproduit dans le recueil R0, Gaffes et gadgets (Charleroi, Dupuis, 1985, p.3) :
« Qui êtes-vous ?
– Gaston.
– Qu’est-ce que vous faites ici ?
– J’attends.
– Vous attendez quoi ?
– J’sais pas… J’attends…
– Qui vous a envoyé ?
– On m’a dit de venir…
– Qui ?
– ’Sais plus…
– De venir pour faire quoi ?
– Pour travailler…
– Travailler comment ?
– ’Sais pas… On m’a engagé…
– Mais vous êtes bien sûr que c’est ici que vous devez venir ?
– Beuh… »
[14] Dominique Lafontaine, « Oh, Monsieur Gaston, comme vous parlez bien ! : une étude des variations sociolinguistiques dans Gaston Lagaffe », Enjeux : Revue de Formation Continuée et de Didactique du Français, vol. 5, pp. 27-36.
[15] Cf., Jean-François Marmion, Psycho pop. Une plongée déconnante dans la psychologie des héros et anti-héros, Bruxelles, De Boek supérieur, 2022.
[16] Sur la contre-culture, cf., Christiane Saint-Jean-Paulin, La Contre-culture. États-Unis, années 60 : naissances de nouvelles utopies, Paris, Autrement, 2008 ; Frédéric Robert, Révoltes et utopies : la contre-culture américaine dans les années 1960, Rennes, Presses universitaires de Rennes, 2011.
[17] Spirou a été inventé en 1938 par Jean Dupuis, Rob-Vel (pseudonyme de Robert Pierre Velter) et Blanche Dumoulin.
[18] Le marsupilami apparait donc en 1952 dans Les héritiers (Charleroi, Dupuis), une aventure de Spirou et Fantasio.
[19] Alain Dister, La Beat Generation, La révolution hallucinée, Paris, Gallimard, coll. « Découvertes », 1997 ; William Lawlor, Beat culture : lifestyles, icons, and impact, ABC-CLIO, 2005.
[20] Nicolas Rouvière, « Trois figures antimusicales de la BD franco-belge : la Castafiore, Gaston Lagaffe et Assurancetourix », Recherches & Travaux, n°78, 2011, pp.195-212.
[21] Nous pouvons citer les gags 272 et 274 (Le bureau des gaffes en gros [1965], R2, 1972).
[22] Philippe Birgy, « “Si cette histoire vous amuse, on peut la recommencer” : Le yéyé et l’importation de la contre-culture américaine », Volume, vol. 9 : 1, no1, 2012, pp. 151-167.
[23] Pour un témoignage sur cette époque, voir Jean-Pierre Bouyxou et Pierre Delannoy, L’aventure hippie, Paris, Éditions du lézard, 1995.
[24] Par exemple, les gags 530B (Un gaffeur sachant gaffer, n°7, 1969) ou 590B (Lagaffe nous gâte, n°8, 1970).
[25] Voir le gag 600 (Lagaffe nous gâte, n°8, 1970). Sur Gaston et la musique, voir Lagaffe en musique, Monaco, Marsu Productions, 2012.
[26] La dernière aventure de Spirou dessinée par Franquin est Panade à Champignac (qui débute dans le numéro 1539 du 12 octobre 1967 du journal Spirou et s’achève au numéro 1556 du 8 février 1968). Elle sera reprise en album en 1969, accompagnée de l’épisode Bravo les Brothers, qui doit être vu comme une histoire de Gaston Lagaffe.
[27] Lagaffe mérite des baffes, 1979.
[28] Frédéric Potet, « Gaston Lagaffe, icône antimilitariste, antiflics et écolo avant l’heure », art. cit.
[29] José-Louis Boquet et Eric Verhoest, Franquin, chronologie d’une œuvre, Monaco, Marsu Production, novembre 2007, p. 102 ; Numa Sadoul et André Franquin, Et Franquin créa la gaffe, op. cit., pp. 45-50.
[30] Sur la notion de décroissance, voir André Gorz, Éloge du suffisant, Presses universitaires de France, 2019 ; Cédric Biagini, David Murray et Pierre Thiesset (eds.), Aux origines de la décroissance : Cinquante penseurs, Paris/Montréal, L’Échappée/Écosociété, 2017.
[31] Valeria Siniscalchi, « Slow versus fast », Terrain [En ligne], n°60, mars 2013, http://journals.openedition.org/terrain/15122, consulté le 13 octobre 2022.
[32] La Saga des gaffes, 1982.
[33] Idem.
[34] Numa Sadoul et André Franquin, Et Franquin créa la gaffe, op. cit., p. 72.
[35] Il s’agit d’une Fiat 509 coupé royal de 1925.
[36] Sylvanie Godillon, Gaële Lesteven et Sandra Mallet, « Réflexions autour de la lenteur », Carnets de géographes [En ligne], 8 | 2015, mis en ligne le 01/09/2015, consulté le 07 septembre 2023, URL : http://journals.openedition.org/cdg/281
[37] Centre Georges Pompidou, « Gaston, au-delà de Lagaffe », Paris, 7 décembre 2016-10 avril 2017. https://www.centrepompidou.fr/fr/programme/agenda/evenement/cy5Rdgg.
[38] Par exemple le gag 905B, Gaffe à Lagaffe, Marsu Prod, 1996.
[39] Paul Lafargue, Le droit à la paresse, Paris, Mille et une nuits, 1994.
[40] Frédéric Potet, « Gaston Lagaffe, icône antimilitariste, antiflics et écolo avant l’heure », art. cit.
[41] Amaury Grimand, « Appropriation et construction du sens au travail. Les leçons de management de Gaston Lagaffe », Revue française de gestion, vol. 303, n°2, 2022, pp. 105-124.
[42] Gag 829, Lagaffe mérite des gaffes, n°13, 1979.
[43] Lewis Caillat, « La machine à faire des ronds de fumée de Gaston Lagaffe », Esprit, 1982, https://esprit.presse.fr/article/caillat-lewis/la-machine-a-faire-des-ronds-de-fumee-de-gaston-lagaffe-31746. Consulté le 15 octobre 2022.
[44] Bruno Latour, « Portrait de Gaston Lagaffe en philosophe des techniques », in Bruno Latour (dir.), Petites leçons de sociologie des sciences, Paris, La Découverte, 2007, pp. 13-24.
[45] https://www.cite-sciences.fr/fr/ressources/evenements-passes/gaston-de-lidee-a-la-gaffe.
[46] Lewis Caillat, « La machine à faire des ronds de fumée de Gaston Lagaffe », art. cit.
[47] Sur le mouvement Dada, cf., Marc Dachy, Dada et les dadaïsmes, Paris, Gallimard, 1994 ; Laurent Lebon (dir.), Dada, catalogue d’exposition, Centre Pompidou, 2005.
[48] Jean-Claude Bonnet, Diderot : Textes et débats, Paris, Librairie Générale Française, 1984. Michèle Duchet, Anthropologie et histoire au siècle des Lumières : Buffon, Voltaire, Rousseau, Helvétius, Diderot, Paris, Maspero, 1971 ; Peter Jimack, Peter, Diderot : Supplément au Voyage de Bougainville, London, Grant & Cutler Ltd., 1988. Voir aussi Philippe Descola, Par-delà nature et culture, Paris, Gallimard, « Bibliothèque des sciences humaines », 2005.
[49] Gags n°850A et 850, Lagaffe mérite des baffes, 1979. Le début de ce gag est à chercher dans le douzième volume des aventures de Gaston, Le gang des gaffeurs (1976), dans les gags 799, 800 et 804, pp. 41, 42 et 45.
[50] Les gags ayant un aspect écologique ont été compilés dans l’anthologie intitulée L’écologie selon Lagaffe, Monaco, Marsu Productions, 2009. De même, il y a eu une autre anthologie, chez le même éditeur, portant sur la biodiversité, La biodiversité selon Lagaffe, Monaco, Marsu Productions, 2010.
[51] Lagaffe mérite des baffes, n°13, 1979. Voir Cynthia Laborde, « Se presser de rire de tout de peur d’avoir à en pleurer : Franquin, Lagaffe, et l’environnement », The French Review, Johns Hopkins University Press, vol. 90, n° 2, 2016, pp. 117-129.
[52] Gag 652, Le cas Lagaffe, n°9, 1977.
[53] Gag 809, Lagaffe mérite des gaffes, 1979.
[54] Cela dit, l’exposition de 2016 du Centre Georges Pompidou consacrée à Gaston Lagaffe reproduit une lettre d’une commerciale parisienne qui souligne que l’album Des gaffes et des dégâts, qui vient de paraître (nous sommes en 1968, peu avant Mai 68) a été « “déposé” à la “Commission de surveillance et de contrôle des publications destinées à l’enfance et à l’adolescence », mise en place par la loi de 1949. Le risque de censure pèserait grandement sur l’ouvrage, selon cette commerciale : « Le principal argument de cette commission est que la jeunesse française a suffisamment l’occasion d’entendre autour d’elle dénigrer et ridiculiser la police sans qu’il soit nécessaire, en plus, de lui fournir des exemples dessinés. Tout ceci peut paraître puéril et rétrograde, mais […] si nous voulons continuer à obtenir facilement les autorisations nécessaires, il ne faudrait peut-être pas renouveler trop souvent ces incidents ». » Frédéric Potet, « Gaston Lagaffe, icône antimilitariste, antiflics et écolo avant l’heure », art. cit.
[55] Numa Sadoul et André Franquin, Et Franquin créa la gaffe, op. cit., p. 64. Voir le gag 631 (Lagaffe nous gâte, n°8, 1970).
[56] Erwin Dejasse, « Ce Spirou qui m’emmerde », in Meesters, Gert ; Vrydaghs, David ; Paques, Frédéric (eds.), Les métamorphoses de Spirou : Le dynamisme d’une série de bande dessinée, Liège, Presses Universitaires de Liège, 2019, p. 120.
[57] Numa Sadoul et André Franquin, Et Franquin inventa la gaffe, op. cit., p. 72.
[58] Passages à tabac, torture à l’électricité (sur les parties génitales), drogues, viol de sa compagne devant lui, simulacre d’exécution…
[59] Gag non numéroté, Gaffe à Lagaffe, n°19, Marsu Prod.1999, p.33.
[60] Gag 887, La saga des gaffes, n°14.
[61] Les gags 890A et 980B, La saga des gaffes, 1982, n°14.
[62] Gag n°870, La saga des gaffes, 1982.
[63] Par exemples, les gags 315 et 359, Gare aux gaffes du gars gonflé, R3, 1989.
[64] Gag 316, Gare aux gaffes du gars gonflé, R3, 1989.
[65] Par exemple, les gags 582 B (Lagaffe nous gâte, n°8, 1970).
[66] Par exemple, dès le gag n°1, lorsque Gaston fait tomber un sac de noix, qui font tomber des soldats défilants, désorganisant de fait ce défilé (Gaston n°0, « Gaffes et Gadgets », 1985). Nous pouvons aussi citer les gags 486B et 576B, où le gaffophone perturbe le vol d’avions de chasse (respectivement Un gaffeur sachant gaffer, n°7, 1969 et Lagaffe nous gâte, n°8, 1970) ; le gag 589B (Lagaffe nous gâte, n°8, 1970), où une maquette d’avion de chasse, pilotée par Gaston finit dans les fesses d’un général ; le gag 690 où un ramonage à l’explosif transforme des protections de cheminée en missiles qui détruisent un avion de chasse (Le géant de la gaffe, 1972) etc.
[67] Marie-Catherine Oppenheim, « Euromissiles : la dernière bataille Est-Ouest », L’Histoire, no 210, mai 1997, https ://https://www.lhistoire.fr/euromissiles-la-derni%C3%A8re-bataille-est-ouest. Consulté le 07/09/2023.
[68] La saga des gaffes, n° 14, 1982.
[69] Numa Sadoul et André Franquin, Et Franquin créa la gaffe, op. cit., p. 63.
[70] Publiés dans le Journal de Spirou, ils seront collectés dans deux volumes de Gaston, Lagaffe mérite des baffes, n°13, 1979 et La saga des gaffes, n° 14, 1982.
[71] L’agent Longtarin apparaît comme personnage secondaire en 1964, dans l’album Gaffes à gogo.
[72] Frédéric Potet, « Gaston Lagaffe, icône antimilitariste, antiflics et écolo avant l’heure », art. cit.
[73] Numa Sadoul et André Franquin, Et Franquin créala gaffe, op. cit., pp. 157-158.
[74] Voir le courrier cité dans la note 31.
[75] Voir Max Stirner, L’Unique et sa propriété et autres écrits, Lausanne, L’âge d’homme, 1972. Sur les différentes formes d’anarchisme, voir Daniel Colson, Petit lexique philosophique de l’anarchisme. De Proudhon à Deleuze, Paris, Livre de poche, 2001.
[76] Voir Howard Becker, Outsiders. Études de sociologie de la déviance, Paris, Métailié, 2020.
[77] Numa Sadoul et André Franquin, Et Franquin créa la gaffe, op. cit., p. 161.
[78] Cf., André Franquin, Cauchemarant, Bédérama, 1979 et 1981.
[79] Eric Hobsbawm, L’âge des extrêmes. Le court XXe siècle 1914-1991, Agone, 2020.
📽️ vidéo en ✊ Djamil Le shlag, Louisa Yousfi, Médine : CARTE BLANCHE art et politique: -- ZR3GZLeZ5no?version=3 #DjamilLeShlag #LouisaYousfi #Médine #CarteBlanche #ArtEtPolitique
Djamil Le shlag, Louisa Yousfi...
La Science-fiction en Russie depuis les années 1990
Avec cet ouvrage, Du libéralisme au nationalisme. La politique dans les littératures de l’imaginaire russes post-soviétiques (Lingva, 2025),Viktoriya et Patrice Lavoye, spécialistes des littératures de l’imaginaire et de la science-fiction ukrainienne et russe, nous offrent une étude particulièrement intéressante sur l’évolution politique de la science-fiction russe depuis la disparition de l’URSS. Le corpus étudié (livres et entretiens) reflète les transformations sociales et politiques, qui ont été parfois violentes, de la Russie depuis la chute de l’URSS. L’un de ses points forts, et ils sont nombreux, est la contextualisation historique. Les auteurs reviennent longuement sur la période Eltsine – qui s’étend de 1991 à 1999 – et sur le traumatisme pour la population, sur les plans économique, politique et géopolitique. Les auteurs prennent le temps d’expliquer un contexte complexe pour le lecteur occidental. De fait, les deux chapitres portant sur ces thématiques font un quart de l’ouvrage. Ils sont essentiels pour appréhender la suite, c’est-à-dire comprendre les évolutions des écrivains de l’imaginaire russe, notamment leur discours anti-occidental et anti-libéral, les deux étant associés à la période où Boris Eltsine a gouverné le pays.
Les nombreuses et longues citations le montrent parfaitement : cette période est restée dans les mémoires comme une époque de déclin politique et économique et de décadence morale. Les écrivains cités insistent sur ces aspects, parfois de façon subtile, parfois de façon brutale. Viktoriya et Patrice Lavoye nous montrent que l’évolution nationaliste, et parfois conservatrice, des écrivains de l’imaginaire prend naissance dans ce traumatisme. De même, ce registre, marqué en URSS par la croyance dans un progrès scientifique (voir notre recension d’Étoiles Rouges. La littérature de science-fiction soviétique, sur ce même site), se laisse progressivement influencer par l’orthodoxie dans une variante très conservatrice. Afin de permettre au lecteur qui n’aurait pas lu Étoiles Rouges d’avoir cette perspective, le couple consacre par ailleurs un long chapitre sur l’histoire de ces littératures en URSS, de sa fondation à sa disparition.
Le reste de l’étude porte donc sur le sujet propre du livre : l’évolution conservatrice et nationaliste de ces écrivains, analysant leurs thématiques de prédilection : la dystopie, l’uchronie, voire l’invention de mondes totalement imaginaires, sur le modèle de l’Heroic fantasy.
Les citations montrent une nostalgie de l’URSS, non pas du communisme, mais du sentiment donné de sécurité sociale. Les persécutions parfois subies par les écrivains de l’imaginaire laissent place à l’idée d’un régime plus bénéfique pour la population que le libéralisme eltsinien. Vue la violence de la transition politique et économique, ce n’est guère surprenant. Parfois, cette nostalgie va plus loin, avec une promotion d’un retour au tsarisme et à l’orthodoxie. Plus globalement, on peut dire que ces écrivains développent une vision désabusée de la Russie.
Pour mener cette tâche, les auteurs s’appuient à la fois sur un corpus large d’écrivains de l’imaginaire et sur de nombreuses citations, parfois longues, laissant la pensée des écrivains cités s’exprimer clairement. De même, la bibliographie est impressionnante, tant la partie scientifique que celle des auteurs compulsés. Enfin, les nombreuses notes, scientifiques et de contextualisation, complètent cette étude, qui si elle ne présente pas comme universitaire, l’est dans sa démarche.
Un petit bémol néanmoins, les quelques coquilles restantes. N’oublions pas cependant l’essentiel : il s’agit d’une ressource précieuse pour ceux qui s’intéressent à la littérature, à la politique et à la culture russe post-soviétique. Il nous permet aussi de comprendre l’évolution des mentalités des Russes contemporains. Comme ce sujet est peu connu en France, voire en Occident, il s’agit d’un ouvrage hautement recommandé.
La Terre creuse, entre caverne originelle aryenne et mythologie politique transnationale
Première parution : Nicolas Lebourg, « La Terre creuse, entre caverne originelle aryenne et mythologie politique transnationale », Julien d’Huy, Frédérique Duquesnoy, Patrice Lajoye dir. Le Gai sçavoir. Mélanges offerts à Jean-Loïc Le Quellec, Oxford, Archaeopress, 2023, pp. 147–154.
En 2022, Jean-Loïc Le Quellec a publié un ouvrage anthropologique majeur, où, sur la base de l’art pariétal, il traite des 749 occurrences qu’il a trouvé à travers le monde du mythe d’une « émergence primordiale » faisant qu’une partie de la Création passe de la « caverne originelle » à la surface[1]. Un tel sujet interpelle l’historien des extrêmes droites qui, sans avoir de culture préhistorique sérieuse, croit entendre l’écho d’une vague idée croisée de temps à autre, depuis une enfance illuminée par Jules Verne : le thème de la Terre creuse. C’est certes un mythe littéraire, mais aussi un mythe politique, spirituel, et même pop-culturel. Il est vrai que les frontières peuvent être fines. Après un tour d’horizon des sens donnés au mot « mythe », Jean-Loïc Le Quellec a proposé cette lapidaire définition des mythes : « ils décrivent un ordre ancien du monde et racontent un bouleversement qui y survint ; ce qui explique l’état actuel des choses »[2]. C’est exactement là la structure des histoires de la Terre creuse, qu’elles s’ébrouent dans la littérature, l’ésoterisme politique, ou entre les marges politiques et le mainstream pop-culturel.
Mic-mac romanesque et bric-à-brac occultiste
Si le travail de Jean-Loïc Le Quellec éclaire une préhistoire du mythe de la caverne originelle, les tenants de la croyance en la Terre creuse citent allègrement divers mythes antiques, tels que celui de Perséphone, pour arguer que leurs usages des mythes serait un mode d’accès à des connaissances enfouies. De prime abord, ces rapprochements ne sont pas faux : il fut effectivement produit durant des siècles des récits quant à l’habitat interne de la planète. Néanmoins, on ne peut raisonnablement suivre cette piste très souvent évoquée, même par ceux qui veulent être les observateurs rationalistes d’une pensée fantastique. En effet, les Grecs ou Dante considéraient cette intra-Terre sur un plan cosmogonique, ce qui diffère Au XVIIIè siècle, la réflexion se détache de la cosmogonie avec l’expression « théorie de la Terre » qui fait fortune – et nuit ainsi au timide premiers usages de « géologie ». Nombre d’auteurs européens l’utilisent pour désigner leur production d’une proposition d’explications de la structure et de l’histoire tant de l’intérieur de la planète que de ses reliefs. L’ingénieur français des Ponts et Chaussées Henri Gautier ou l’astronome britannique Edmond Halley fournissent ainsi des hypothèses de Terres creuses dans le cadre de leurs démarches scientifiques[3]. La parution en 1741 du roman fantastique Voyages souterrains de Niels Klim du Danois Ludvig Holberg souligne combien le thème est avantageux pour les façonneurs d’imaginaire.
Les premières réelles thèses de Terre creuse se voulant à rebours du paradigme scientifique en vigueur remontent au XIXè siècle. Il s’agit peut-être, au bout de l’extension coloniale de l’Europe, une fois le monde fini, de perpétuer le rêve de découvertes. En tous cas, la science se fait fiction, sans que l’horizon soit réduit à l’avenir. C’est d’ailleurs le citoyen d’une ancienne colonie, l’Américain John Cleves Symmes, qui se fait le premier activiste d’une véritable révélation. A partir de 1818, il échafaude un système où la planète est en fait composée de cinq sphères concentriques – à compter de 1824, il ne propose plus qu’une seule sphère creuse. Il tente de mettre en place des expéditions aux pôles, rares espaces encore inexplorés et dont il pense qu’ils constituent les entrées à l’intérieur du monde. S’il va à l’encontre des acquis scientifiques, Symmes participe néanmoins, à sa façon, à un goût américain de son époque pour une science géographique exploratoire. C’est ce qui fait de lui l’unique théoricien de la Terre creuse ayant connu un moment de relative popularité, tandis que son idée d’accès polaire au centre de la planète devait connaître une importante postérité romanesque[4]. Parmi celle-ci, se détache bien sûr Jules Verne au premier chef.
La descente physique peut ici valoir remontée du temps : quand le Nautilus de Verne s’aventure au fond des mers, il y trouve l’Atlantide ; quand ses personnages visitent le centre de la Terre, ils y retrouvent des dinosaures. Cette valeur d’anamnèse de passés mythifiés se lie au mythe lui-même, qui devient ainsi plus historique que géologique. Ici aussi pèse peut-être le cadre colonial : comme l’a analysé Jean-Loïc Le Quellec un bon millier de « romans scientifiques » sont produits à cette époque qui expliquent telle ou telle présence archéologique remarquable en Afrique par la venue jadis de civilisateurs blancs, diverses fois dits en provenance de l’Atlantide[5]. L’exploration de l’espace extra-européen ramène aux passés de l’homme blanc, et ces derniers se fixent dans les mondes souterrains et les continents engloutis. Cette tendance a le mérite de placer la fin du monde avant le lecteur de l’eschatologie.
Un paradoxe est installé : le roman est un objet historique agissant, et non un simple bien culturel. Les adeptes de la Terre creuse n’auront de cesse de considérer que le travail de Verne n’est pas tout à fait de fiction et offre des clefs, tout comme d’autres romans à la suite seront faits matériaux d’une histoire mystérieuse. Un deuxième paradoxe émerge : nombre de ceux qui écrivent sur la Terre creuse y voient une folie, mais élaborent également des allers-retours entre fictions et histoire réinventée. Ainsi le journaliste américain William Bell écrit-il que les membres de la Société Thulé avaient « certainement » lu Jules Verne et ainsi transmis la mythologie de la Terre creuse aux nazis, jusqu’à ce qu’Hitler et Himmler soient des adeptes de la thèse de la Terre creuse concave[6]. Celle-ci a été imaginée par Cyrus Reed. Cet Américain a connu une illumination en 1869. Prenant le nom de Koresh, il se fait le prophète d’une « cosmologie cellulaire » : la surface de la Terre est vide, les continents sont fixés sur sa surface interne, le soleil et la lune flottent en son centre. Si la thèse peut sembler claustrophobique, Reed y voit une libération : si l’univers est fini, la paix sociale serait à portée de main – la secte qu’il fonde entreprend la construction d’une Nouvelle Jérusalem reprenant les formes de cette Terre creuse concave. Si cette représentation a bien été introduite dans l’Allemagne de Weimar, l’idée qu’elle ait pénétrée les cercles dirigeants nazis relève des fantasmagories popularisées par le succès mondial du Matin des magiciens des Français Louis Pauwels et Jacques Bergier publié en 1960[7]. Moins qu’avec les racines du nazisme, la cosmologie cellulaire a à voir avec le fourmillement évangélique américain de son époque.
Par ailleurs, la fin du XIXè est riche de littérature grosse de prospérité. L’écrivain britannique Edward Bulwer-Lytton apporte en 1871 une dimension moderniste dans un roman où il conte qu’une race souterraine d’hommes détient une immense énergie mystique, le « Vril ». Le français Louis Jacolliot reprend le thème en situant le royaume souterrain en Inde et en le baptisant « Agartha » (1873), de même qu’il s’intéresse aux continents engloutis. On a là quelques-uns des mythèmes destinés à nourrir l’œuvre d’Helena Petrovna Blavatsky.
En 1875, cette mystique russe fonde à New York la Société théosophique, censée diffuser les enseignements que lui auraient confiés, dans la cité souterraine de Shambhala (un nom emprunté à la mythologie bouddhique) dans le désert de Gobi, les Mahatma, des Maîtres cachés issus de l’effondrement du continent de la Lémurie – tandis que d’autres auraient migré vers l’Atlantide, et les derniers dans les cavernes – dont l’enseignement pourrait sauver la dernière humanité en date, celle des Aryens (la cosmogonie théosophique reprenant les cycles humains de l’hindouisme). A partir de 1905, les théosophes américains ramènent le mystère souterrain à domicile. Ils forgent une identité secrète au mont Shasta (Californie, l’ultime frontière de la « Destinée manifeste » se faisant sas entre les mondes), dont les entrailles seraient les refuges des Maîtres Ascensionnés. Si les rosicruciens font ensuite du mont le seul vestige de la Lémurie ayant survécu au Déluge, certains songent que les cités lémures y vivent encore. Tous s’accordent pour surnommer le mont Shasta « la nouvelle Shambhala ». Après qu’en 1934, Guy Ballard ait affirmé avoir rencontré sur ses flancs le comte de Saint-Germain, s’y développe la mouvance ésotériste « I AM », puis d’autres mouvances comme la new age Église universelle et triomphante d’Élisabeth Clare Prophet. Il y a une dizaine d’années, il était estimé que sur les 25 000 touristes annuels visitant le site, un tiers étaient des pèlerins ésotéristes[8].
Fort souvent, Shambhala se voit toutefois préférer le nom d’Agharttha avec la parution en 1910 d’un ouvrage posthume de l’ésotériste français Alexandre Saint Yves d’Alveydre qui en fait un vaste royaume de vingt millions d’âmes vivant sous une utopie synarchique réalisée. Connu d’un demi-milliard d’Asiatiques, protégé par un « bouclier » de quarante millions d’hommes, le sanctuaire s’étendait jadis de l’Inde jusqu’aux sous-sols de l’Amérique, puis s’installa sous l’Himalaya au-dessus d’un Océan de feu[9]. Le XIXè s’est achevé en creusant même la Lune : en 1901, HG Wells publie The First Men in the Moon, où les explorateurs humains découvrent une civilisation lunaire souterraine.Une fois l’Europe couverte de tranchées, le mythe remet les pieds sur Terre.
La Cité souterraine, entre utopie et dystopie
L’entre-deux-guerres élabore d’abord des continuités des récits mis en place avant 1914, puis les surinvestit, entre autres politiquement. A l’heure où il s’agit de dépasser les nations pour forger de nouveaux empires, le propos est moins celui d’une Terre totalement creuse à habiter, que la découverte de territoires souterrains pouvant fournir l’énergie à la construction des projets géopolitiques. Approfondissant la dimension ésotérique du mythe, il faut y descendre, s’y transformer, revenir changer le monde.
L’attrait russe pour l’Agartha se comprend par le développement fin XIXè de thèses poussant la Russie à s’agrandir vers son Sud-Est pour compenser le poids de l’Occident, en particulier vers le Tibet (Lhassa étant perçue telle la Rome de l’Asie), dont les prophéties liant Shambala à un royaume sacré eschatologique au Nord préfigureraient l’attente de l’impérialisme russe. Pour le prince Esper Uxtomskij, précepteur de Nicolas II, l’attente du « Tsar blanc » par les peuples tibétains ne fait pas de doute, d’autant que les deux peuples seraient de la même ascendance aryenne[10]. L’invention de l’Agartha est reprise avec succès en 1924 par Ferdynand Ossendowski, séparatiste sibérien devenu Russe blanc qui fait de l’Agartha le sanctuaire du « Roi du Monde » – thème et terme adoptés par René Guénon à sa suite. La même année, le rosicrucien polonais, et adepte de la Terre creuse, Włodzimierz Tarlo-Maziński fonde une Union Synarchique qui cherche à réaliser hic et nunc les préceptes politiques régentant l’Agartha[11].
Artistes, penseurs ésotéristes et russes blancs, Nicolas et Helena Roerich cherchent à partir de 1925 une Shambhala dont la description qu’ils font est directement inspirée de l’Agartha de Saint Yves d’Alveydre, mais avec un fort contexte bouddhiste et mongol, et dont les tunnels et caves s’étendraient de l’Altaï à l’Himalaya. Les Mahatma (Galilée, Confucius, Léonard de Vinci, etc.) s’y seraient installés après la chute de l’Atlantide et y auraient constitué le « Gouvernement Invisible et International ». Le couple en a déduit un projet : l’édification d’une « Union sacrée de l’Est » devant réunir les peuples mongols, tibétains et sibériens dans une théocratie mêlant leurs conceptions du bouddhisme et de la théosophie. Ils sollicitèrent l’appui de la Russie bolchevique, puis du ministre de l’Agriculture des États-Unis Henry Wallace (lui-même marqué par la théosophie), pour réaliser cette utopie qui n’était pas que géographique mais participait des projets intégralistes de l’entre-deux-guerres. Après avoir proposé à Moscou de transformer le monde par une quasi-fusion du bouddhisme et du communisme, ils purent présenter leur projet au président Roosevelt en 1935. Ils tentèrent de le convaincre qu’une Mandchourie et une Mongolie investies par des coopératives américaines feraient contrepoids au Japon[12].
Parti de maîtres occultes guidant l’humanité vers l’ascension spirituelle pour aboutir à des projets concrets de transformation politique, le mythe est ainsi devenu un objectif donnant une orientation idéologique, c’est-à-dire qu’il était passé de la science-fiction à ce que Georges Sorel considérait dans ses Réflexions sur la violence (1908) être le mythe politique : une représentation mobilisatrice, vérité absolue et indivisible organisant l’action collective. Parmi les projets de réorganisation de l’Asie, on ne s’étonnera donc pas de retrouver l’Agartha dans le néo-eurasisme du russe Alexandre Douguine. Elle y apparaît doublement. D’abord, en tant que justification de la mission eurasiste de la Russie située entre l’Hyperborée et l’Agartha : sa réalisation a une visée eschatologique, devant signifier la fin du Kali-Yuga et l’avènement du Roi du Monde. Ensuite, comme le nom d’un réseau occulte au sein du renseignement militaire de la fin de l’Union soviétique[13].
Eu égard aux imaginaires mobilisés, on ne saurait s’étonner que la fantasmagorie d’Agartha trouve son revers. Comme l’avait déjà noté Raoul Girardet, le souterrain est une figure essentielle de la description des conspirations maléfiques[14]. Du labyrinthe refaçonnant l’initié, la caverne passe donc naturellement à la matrice du complot malfaisant. Le cas est spectaculaire relativement à la Synarchie : l’utopie réalisée en Agartha se meut en projet politique ennemi, la « Fraternité blanche » en conjuration occulte. Sous Vichy, est dénoncé un Mouvement synarchique d’Empire, complot technocratique servant le capitalisme juif, mais également instrument du fascisme de « droite » : le Service des sociétés secrètes considère ainsi que la Synarchie, infiltrée dans le nazisme, a bloqué les mesures sociales du Troisième Reich[15].
L’après-guerre voit la presse communiste dénoncer le complot synarque, patronal et réactionnaire, tandis que celle d’extrême droite le pourfend en tant qu’initiative mondialiste, bien souvent judéo-maçonnique. La Cité idéale du monde souterrain est réduite au totalitarisme d’en-face, et le thème de l’Agartha défait de ses vertus pour n’être qu’un élément de son folklore. La Synarchie n’est plus qu’une injure, transatlantique désormais. Le péronisme argentin trouve là un mot pour nourrir son interclassisme, qu’il veut populaire. Le mouvement de Lyndon LaRouche dénonce dans la Synarchie le complot ayant donné jour aussi bien au jacobinisme qu’au bolchevisme en passant par le nazisme[16]. En France, le terme demeura dans le discours nationaliste jusqu’à la fin du XXe siècle, qu’il s’agisse pour la Fédération des étudiants nationalistes de prétendre que la Synarchie s’est reformée grâce à la fondation en 1945 de l’École nationale d’administration, pour le Mouvement Occident d’arguer qu’elle est un des instruments de la « judéo-maçonnerie », pour les néo-nazis français de la World Union of National-Socialists d’user de la « Synarchie » comme un masque transparent de ce qui eût été antérieurement nommé le « judaïsme international », pour les « socialistes européens » (partisans d’une Europe blanche des ethnies) d’y voir le point de rencontre de la technocratie mondialiste et du « sionisme », quand d’autres néofascistes ont pu la concevoir comme l’instrument technocratique de la domination universelle « américano-sioniste », etc.[17].
Toutefois, la Synarchie devait être un mot abandonné par l’extrême droite radicale à compter des années 1980. On comprend pourquoi en croisant l’une de ces ultimes occurrences dans le périodique antisémite et négationniste Révision, tenu par un ex-Autonome aux problèmes psychiatriques établis : la Synarchie est dite avoir financé la Cagoule, les ligues et le Front populaire, Vichy et les Alliés, et contribuer à ce que la Seconde guerre mondiale s’achève sur ce qui serait la victoire des juifs. L’antisémitisme a certes encore de beaux jours devant lui, mais un tel passéisme des références est incapacitant[18]. Le thème trouve dès lors refuge à gauche à partir des années 1990, tout d’abord au Réseau Voltaire, détaché des gauches à partir de son conspirationnisme post-11 septembre mais y étant inclus jusque-là. Mais ce sont surtout les ouvrages d’Annie Lacroix-Riz, retrouvant la fibre de la dénonciation de la collusion patronat-fasciste dans le complot synarchiste, qui redonnent un vrai élan au mythe et le relégitime à gauche… Figure atypique mais non asymptomatique, Jean-Pierre Chevènement la cite ainsi en tançant le complot des « organisations d’extrême droite (Synarchie et Cagoule) » qui eussent noyauté l’Etat…[19] N’importe : la question n’est plus que l’intra-monde vienne régénérer les sociétés, mais la création d’un monde “à plat”, transnationalisé par le truchement semi-paradoxal d’un mythe transnational. Le fait qu’il pointe largement ce qu’il considère être le mondialisme technocratique des élites relève bien en revanche d’une continuité de la fantasmagorie anti-synarchie, ainsi passée de l’utopie forgée sur un savoir ancestral au cauchemar en route mais aux origines antédiluviennes.
Subcultures et post-modernité
C’est en 1960 que le nazisme se rattache vraiment à la théorie de la Terre creuse, autant dire non exactement à son acmé… Louis Pauwels et Jacques Bergier publient alors Le Matin des magiciens, qui connaît un succès fulgurant et phénoménal : un million d’exemplaires en France et une dizaine d’éditions étrangères[20]. L’ouvrage fabrique une réalité alternative où l’Histoire est le fait de complots ésotériques. Selon son propos, le « nazisme originel » et Hitler croyaient que nous vivons à l’intérieur de la Terre et que le « Roi de la peur », vivant dans une cité encore plus souterraine en Asie, offrait le pouvoir sur les continents à qui pactisait avec lui – le Vril intra-terrestre assurant la puissance. Hitler lui-même eût cru être en contact avec les « Supérieurs Inconnus » de la théosophie, réfugiés sous notre sol. Mais par-delà, assurent les auteurs, « pour l’Allemand de la rue dont l’âme avait été labourée par la défaite et la misère, l’idée de la Terre creuse, aux environs de 1930, n’était pas plus folle, après tout, que l’idée selon laquelle des sources d’énergie illimitée seraient contenues dans un grain de matière »[21]. Le phénomène d’édition lance une vague narrative sur « l’occultisme nazi » touchant dans les décennies suivantes l’ensemble des médias (cinéma, bande dessinée, jeu vidéo etc.) et fait passer la petite secte völkisch qu’était la Société Thulé pour le centre névralgique secret du nazisme[22]. On retrouve également l’ouvrage de Pauwels et Bergier à l’origine du récit faisant des fresques de la Tassili (un plateau que les auteurs transforment… en grotte) des preuves de la visite sur Terre d’extraterrestres géants entourés de leur champ magnétique ; soit une légende assez popularisée pour que des décennies après Jean-Loïc Le Quellec en ait assuré une patiente réfutation[23].
Le succès se répercute dans la radicalité politique, se refaçonnant dans ses ultimes marges en croyant que le légende est le legs historique – il est vrai que nous sommes au même moment où elles s’emparent des pseudos-runes nordiques de la SS comme emblèmes, et où elles commencent également à redessiner leurs dogmes non selon leurs vues propres mais sous l’angle de nouveaux travaux historiques[24]. Ainsi, le néo-nazi chilien Miguel Serrano procède-t-il à une grande fusion mythologique, avec des Hyperboréens d’origine extradimensionnelle qui auraient choisi après l’engloutissement de leur continent (suite à un péché racial de métissage qui n’est pas sans suggérer un décalque de la mythologie juive des Nephilim) de se répartir entre la galaxie, la Terre creuse, un royaume souterrain de Mongolie, et une vie terrestre donnant souche aux Aryens. En 1945, Hitler aurait utilisé une soucoupe volante pour rejoindre l’une des entrées de la Terre creuse, via une base secrète nazie dans l’Antarctique[25].
Manifestement, on a atteint là un haut degré d’hybridation entre pop-culture, théosophie, néo-nazisme, et tout autre élément croisé que l’on peut désormais hybrider au gré de sa fantaisie. Dès lors, il ne s’agit plus que de pousser toujours plus loin. C’est ainsi ce que fait le Livre Jaune n°6, ouvrage antisémite ésotérique mâtiné de théosophie, d’ufologie et tutti quanti, influencé par Serrano mais plus largement diffusé internationalement. Selon lui, « une chose est évidente : la Terre est creuse », comme toutes les planètes. On peut aller depuis les pôles rejoindre cette Hyperborée interne où « le climat est subtropical (…). Tout fonctionne en harmonie et baigne dans l’amour. La capitale se trouve dans un jardin paradisiaque, qui s’appelle Eden. » Le territoire est peuplé de Géants qui ont parfois guidé l’humanité qui les prit pour des dieux, tel l’hyperboréen Appolon[26].
Nonobstant, ces textes s’inscrivent encore dans la perspective d’une régénération utopique de la surface par le centre de la Terre. La pensée obsidionale devait bien sûr arpenter la possibilité d’un Enfer interne, où d’antédiluviennes créatures reptiliennes attendent de soumettre l’humanité (les continuités avec des thèmes issues de la prose de Blavatsky ne cachant pas une rupture fondamentale puisque chez elle les figures draconiques et serpentines des diverses religions antiques renvoyaient à une sagesse supérieure[27]). Ici encore certains matériaux émanent probablement de la littérature pop-culturelle, et plus particulièrement de ses grands maîtres pulp de la première moitié du XXe siècle. Le recours qu’ils opèrent à la figure maléfique du serpent renvoie certes à la culture occidentale, mais dans une histoire amplement indomaniaque on ne peut que songer aux Nâgas, peuple de serpents humanoïdes ayant précédé l’homme et vivant dans le monde souterrain selon la mythologie hindoue. Entre 1914 et 1944, Edgar R. Burroughs, le père de Tarzan, développe une série de romans où la Terre creuse abrite diverses populations dont les cruels Mahars, ptérodactyles humanoïdes dont le nom renvoie à une caste hindoue. C’est ensuite Robert E. Howard qui en 1929 déploie une race préhumaine d’hommes à tête de serpents affrontant un roi atlante exilé – son œuvre suivante centrée autour de Conan le barbare se situant à un « Âge hyborien » consécutif de la Chute de la Lémurie et de l’Atlantide. Ces hommes-serpents complotent et manœuvrent le monde, car métamorphes ils peuvent se faire passer pour des humains. Howard participe au magazine Weird Tales, où officie également Howard P. Lovecraft. Les souterrains d’hommes-serpents pré-atlantes viennent ainsi s’intégrer à la cosmogonie longuement dite du « mythe de Cthulhu », cet univers lovecraftien partagé entre divers auteurs (Les Montagnes hallucinées, l’un des plus célèbres romans de Lovecraft, récemment adapté en manga, paraissant d’ailleurs également emprunté au roman de 1914 de Burroughs). L’ensemble de ces traits devait retrouver les marges politiques radicales avec l’œuvre du britannique David Icke, construisant à la fin des années 1990 un méta-complot rassemblant tous les fantasmes de complot préexistants.
Chapeautant les complots des juifs, des Illuminati etc., le Grand Complot serait l’œuvre des extraterrestres reptiliens que la mythologie sumérienne nommait les Annunaki – l’histoire du serpent au jardin d’Eden en étant une métaphore. L’ensemble des dirigeants de la planète seraient les descendants des reptiliens cherchant à soumettre la race humaine, tandis qu’Hitler aurait été « obsédé par la magie noire » et que Jules Verne eût été un « haut initié » livrant un roman à clefs (voire même un peu plus puisque l’auteur embarque dans sa démonstration l’adaptation cinématographique de 1959 qui ajoutait au roman vernien la présence d’une Atlantide aux hôtes reptiliens au centre de la Terre)…[28] David Icke a su intégrer à son intrigue les récits de ses propres émules, en particulier de Branton, un activiste convaincu qu’une guerre intergalactique multi-millénaire connaît sa phase finale dans la Terre creuse sous les États-Unis, opposant la vision collectiviste et mondialiste reptilienne à la liberté individuelle chrétienne[29].
Quoique David Icke se défende de tout racisme, sa construction renvoie au schéma même des thèses racialistes, reposant structurellement sur l’idée que le moteur de l’histoire est l’affrontement racial[30]. Si, certes, le complot reptilien a été formidablement popularisé, son caractère fantasque est trop net pour être hybridé à des offres politiques électorales. Quelques greffes peuvent avoir été produites aux confins des marges : ainsi l’Action européenne, une internationale néonazie fondée en 1971 par l’ancien collaborationniste Pierre Clémenti, a connu brièvement une section dite de l’Ordre odiniste présentant un cycle d’humanités successives (les premiers hommes se réfugièrent dans l’Agartha intra-terrestre après que les eaux aient noyé l’Ultima Thulé) ; ici les Annanuki sont des Aryens extraterrestres qui eussent été la caste dirigeante des Sumériens et qui auraient guidé la Société Thulé jusqu’aux mystères de la Terre creuse, entre autres…[31] En France, il a fallu la pandémie de Covid-19, dénoncé par David Icke comme une arme reptilienne, pour que ces thèses bénéficient du relais d’une sphère internet entre médecine alternative et technophobie. Même le site d’Alain Soral a attendu ce moment pour diffuser sa première vidéo de David Icke[32].
La pandémie a témoigné que la fantasmagorie n’asséchait plus les possibilités de concentration de capital symbolique : l’ufologue antivax Silvano Trotta, convaincu de la thèse de la Lune creuse, a vu durant l’année 2020 sa chaîne YouTube passer de 15 000 à 170 000 abonnés, tandis que son compte Twitter atteignait deux millions de visites en novembre 2020[33]. Surtout, le complot reptilien a été largement absorbé par la mythologie de la galaxie QAnon. Évolutive, cette dernière proposait dès le départ l’existence de « Deep underground military bases » (soit l’acronyme « DUMB », qui signifie « crétin » en anglais). Parcourant le monde, les DUMB concentreraient des millions d’enfants esclaves, destinés à être violés, torturés, dévorés pour qu’on en extraie l’adrénochrome dont les élites tireraient des propriétés magiques, dont la longévité. Le premier réflexe des classes cultivées a été de mépriser QAnon, et puis il y eut l’attaque du Capitole, et avant, en 2020, à Hanau en Allemagne, ce terroriste d’extrême droite réalisant un massacre contre les étrangers en laissant un manifeste et une vidéo où, entre autres, il évoque les DUMB[34]. En 2022, les milieux QAnon ont souvent interprété l’invasion de l’Ukraine comme une mission camouflant le démantèlement de ces fermes souterraines d’enfants, Vladimir Poutine prenant la suite de Donald Trump en tant que héros de l’humanité.
A ce stade, l’hybridation des thèmes tourne au salmigondis. Le propre de la post-modernité est peut-être que tout revient à la pop-culture, et que tout s’achève dans l’ironie. La popularisation des théories de David Icke a nourri tout un flux de productions artistiques sachant jouer du sarcasme. Si le film germano-belgo-finlandais Iron Sky 2 (2019) proposait un Hitler reptilien chevauchant un dinosaure au centre de la Terre, le rappeur français Vald publiait en 2017 un album intitulé Agartha contenant une chanson Lezarman moquant la mythologie ickienne. Symbole absolu de cette post-modernité tout en références agglutinées, parfois en symbiose, la tétralogie filmique Matrix représente une apogée. La seule ville réelle est Zion, au cœur de la Terre, éternellement détruite et reconstituée sans le savoir (dans la mythologie des trois premiers volets), tandis que l’univers de la surface n’est qu’une réalité illusoire, qui plus est soumise à une stase temporelle : l’homme ne surgit plus de la caverne originelle ; avant et après lui, il n’y a rien que son anéantissement. Matrix achève le thème de la Terre creuse en tant que résidu du passé, comme en tant que voyage initiatique.
Conclusion
Ce voyage au centre de la Terre tourne sempiternellement à droite. Pourtant, l’œuvre et la vie de Georges Sorel nous ont amplement appris que les mythes politiques transcendent voire font imploser le clivage droite-gauche. En fait, c’est que ce mythe nous raconte peut-être ce qu’est la vision du monde radicalement de droite. Les extrêmes droites estiment que leur mission est de régénérer une communauté disparue, ou en risque de disparition. Cela implique un mythe des origines, ou plutôt des cosmologies puisque la pluralité des courants, formations et sentiments nationaux met en concurrence un grand nombre de mythes fondateurs. Le développement de l’aryanisme s’était fait en sachant bricoler une pluralité de mythes : nul n’était besoin de tout en connaître pour approuver l’écrasement de millions d’êtres humains. Greg Johnson, l’une des figures de l’alt-right américaine, analysait récemment dans le compte-rendu d’un ouvrage nommé Le Foyer hyperboréen :
« Nous avons besoin d’un mythe, c’est-à-dire d’une vision concrète, d’une histoire de qui nous sommes et de qui nous souhaitons devenir. Puisque les mythes sont des histoires, ils peuvent être compris et appréciés par pratiquement n’importe qui. Et les mythes, contrairement aux études scientifiques et politiques, résonnent profondément dans l’âme et atteignent les sources d’action. Les mythes peuvent inspirer une action collective pour changer le monde. »[35]
Est un premier élément ce rapport aux valeurs irrationnelles, au désir de changer le monde sans fatalement théoriser précisément l’après (on connaît la formule lapidaire de Mussolini quand on moquait l’imprécision programmatique du fascisme : « Notre programme est simple. Nous voulons gouverner l’Italie »). En outre, ici, changer le monde consiste à réfuter ce que Julius Evola a estimé être le monde bourgeois matérialiste s’imposant à partir de la Renaissance[36]. Le propre de l’extrême droite radicale, c’est qu’elle est in fine le paradigme occidental qui réfute le paradigme produit par l’Occident depuis cette période. Récuser la science, avoir une « alterscience » selon la formule d’Alexandre Moatti[37], est une condition sine qua non de qui veut balayer en l’homme tout ce qui provient de cette ère des valeurs bourgeoises que seraient la démocratie et la raison critique, au profit d’un nouvel homme prométhéen. Structurellement, le désir de narrer la Terre creuse est ainsi proche de la vision du monde de l’extrême droite radicale.
Est aussi singulier que dans la partie politique de notre corpus, ce qui peuple la Terre est quasiment toujours ancien et dangereux : en un siècle le rêve de l’Agartha s’est réduit aux DUMB. Moins qu’un désenchantement des imaginaires littéraires ou historiques, on peut y voir l’orientation décliniste et stricto sensu réactionnaire qu’a tendu à prendre un champ politique toujours plus défait de la part révolutionnaire qu’il avait eu. Par-delà, l’espace-temps est un élément central des représentations du monde et des projets utopiques des extrêmes droites radicales. Le récit racial de l’Histoire élaboré par les nazis les plaçait à ce qui serait l’acmé d’un combat pluri-millénaire, pouvant aboutir soit au « Reich de mille ans », aux dimensions intercontinentales et à la capitale rêvée, Germania, aux structures cyclopéennes, mais dont Adolf Hitler rêvait déjà des ruines, soit aboutir non à la défaite mais à l’anéantissement lors d’une nuit de mille ans[38]. Benito Mussolini avait de moindres ambitions cosmogoniques : le calendrier qu’il imposa structura d’ailleurs moins la temporalité quotidienne que celui élaboré par les nazis. De même, ses rêves d’Empire furent plus ceux d’un décloisonnement de l’Italie qu’un remodelage du monde, même si sa conception du futur relevait avant tout d’une géopolitique[39]. Si les fascistes du premier vingtième siècle furent ainsi des inventeurs de calendriers et de cartographies, car, pour eux, leur avènement était le temps d’un redémarrage et d’une palingénésie, il n’en est pas exactement de même dans le néo-fascisme, qui privilégie le concept de l’interrègne[40], et qui, entre autres, parce qu’il découvre le nazisme avec des biais tels que ceux du Matin des magiciens, importe pourtant à son corps presque défendant le caractère cosmogonique du nazisme.
Est-ce à dire que notre histoire de la Terre creuse se limite à cette dynamique idéologique ? On doit à Jean-Loïc Le Quellec l’intuition que ce n’est pas le cas. En effet, quand il traite de « l’archéologie romantique », il conclut : « au fond, il ne s’agit pas d’archéologie, mais d’une vision du monde, d’une cosmologie, d’une anthropogonie, d’une ethnogonie, bref : d’une mythologie intégrant dans ses discours des éléments d’archéologie »[41]. À dire vrai, l’historien des extrêmes droites n’a rien à ajouter, hormis que ce pourrait-là être une belle définition de son propre champ, et qu’il a donc une dette intellectuelle envers Jean-Loïc Le Quellec.
Notes
[1] Jean-Loïc Le Quellec, La Caverne originelle. Art, mythes et premières humanités, Paris, La Découverte, 2022.
[2] Jean-Loïc Le Quellec, Après nous le Déluge ! L’Humanité et ses mythes, Bordeaux, Le Détour, 2021, p. 15.
[3] Jacques Roger, « La théorie de la Terre au XVIIe siècle », Revue d’histoire des sciences, vol. 26, n°1, 1973, pp. 23-48 ; François Ellenberger, « Quelques idées anciennes sur la constitution interne du globe terrestre », Travaux du Comité français d’Histoire de la Géologie, Comité français d’Histoire de la Géologie, 1984, vol. 2, pp.1-19.
[4] Duane A. Griffin , « Hollow and Habitable Within: Symmes’s Theory of Earth’s Internal Structure and Polar Geography », Physical Geography, vol. 25, n°5, 2004, pp. 382-397
[5]Jean-Loïc Le Quellec, La Dame Blanche et l’Atlantide. Enquête sur un mythe archéologique, Paris, Errance, 2010.
[6] Bill Yenne, Himmler et l’ordre noir. Les origines occultes de la SS, Rosieres en Haye, Camion noir, 2013, p. 87.
[7] Sarah A. Tarlow, « Representing Utopia: The Case of Cyrus Teed’s Koreshan Unity Settlement », Historical Archaeology, vol. 40, n°1, 2006, pp. 89-99 ; Nicholas Goodrick-Clarke, The Occult Roots of Nazism: Secret Aryan Cults and Their Influence on Nazi Ideology, New York, Tauris Parke Paperbacks, 2004, pp. 174-220.
[8] Madeline Duntley, « Spiritual Tourism and Frontier Esotericism at Mount Shasta, California », International Journal for the Study of New Religions, vol.5, n°2, 2014, pp 123–150.
[9] Alexandre Saint Yves d’Alveydre, Mission de l’Inde en Europe, mission de l’Europe en Asie, Paris, Dorbon, 1910 ; Olivier Dard, La Synarchie. Le Mythe du complot permanent, Paris, Perrin, 2012, pp. 68-80.
[10] Marlène Laruelle, « « The White Tsar » : Romantic Imperialism in Russia’s Legitimizing of Conquering the Far East », Acta Slavica Iaponica, n°25, 2008, pp. 113-134.
[11] Jarosław Tomasiewicz et Przemysław Sieradzan, « Włodzimierz Tarło-Maziński – ezoteryczny indywidualista », Rzeczycka Monika et Trzcińska Izabela dir., Polskie tradycje ezoteryczne 1890-1939, 2019, Gdańsk, Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, pp. 206-230.
[12] Dany Savelli dir., Autour de Nicolas Roerich : art, ésotérisme, orientalisme et politique, Slavica Occitania, n°48, 2019.
[13] Alexandre Dougine, Rusia. El mysterio de Eurasia, Madrid, Grupo Libro 88, 1992 ; id., Les Mystères de l’Eurasie, Nantes, Ars Magna, 2018 ; Markus Osterrieder , « From Synarchy to Shambhala: The Role of Political Occultism and Social Messianism in the Activities of Nicholas Roerich », Michael Hagemeister, Birgit Menzel et Bernice Glatzer Rosenthal dir., The New Age of Russia. Occult and Esoteric Dimensions, Berne, Peter Lang, 2012, p114.
[14] Raoul Girardet, Mythes et mythologies politiques, Paris, Seuil, 1986.
[15] Haute Cour de justice, ensemble de pièces sur le Mouvement synarchique d’Empire, AN/3W241.
[16] Humberto Cucchetti, « Droites radicales et péronisme : un mélange de traditions anticapitalistes ? », Olivier Dard dir., Références et thèmes des droites radicales au XXe siècle (Europe-Amériques), Berne, Peter Lang, 2015, pp. 169-189 ; Executive Intelligence Review, Global Showdown : the Russian Imperial Plan for 1988, Washington, EIR Research, 1985.
[17] L’Action nationaliste, 26 janvier 1970 ; Jean-Gilles Malliarakis, Yalta et la naissance des blocs, Albatros, Paris, 1982 ; Direction centrale des renseignements généraux, « Tentative de relance du national-socialisme », Bulletin hebdomadaire. Notes et études, 20 mai 1964, 5 p., AN/19820599/65.
[18] Révision, mai 1990 ; SDRG 92, « L’Aigle noir défenseur des théories révisionnistes se manifeste à nouveau à Issy-les-Moulineaux » 21 novembre 1988, 4 p.
[19] https://www.chevenement.fr/Jean-Pierre-Chevenement-invite-du-colloque-Le-general-de-Gaulle-et-les-elites_a489.html (consulté le 21 décembre 2022).
[20] Pierre Lagrange, « L’occultisme, une étrange passion française. L’histoire du Matin des magiciens, bestseller des années 1960 », Revue du Crieur, vol. 5, n°3, 2016, pp. 120-131.
[21] Louis Pauwels et Jacques Bergier, Le Matin des magiciens, introduction au réalisme fantastique, Paris, Folio, 1972, pp. 390-404.
[22] Stéphane François, Les Mystères du nazisme. Aux sources d’un fantasme contemporain, Paris, Presses universitaires de France, 2015.
[23] Jean-Loïc Le Quellec, « Les Martiens du Sahara. Naissance et postérité d’une légende » Ovni-Présence, n° 51, août 1993, pp. 4-18.
[24] Nicolas Lebourg et Jonathan Preda, « Le Front de l’Est et l’extrême droite radicale française : propagande collaborationniste, lieu de mémoire et fabrique idéologique », dans Olivier Dard dir., Références et thèmes des droites radicales, Bern, Peter Lang, 2015, pp. 101-138 ; Nicolas Lebourg, « La fonction productrice de l’histoire dans le renouvellement du fascisme à partir des années 1960 », Sylvain Crépon et Sébastien Mosbah-Natanson dir., Les Sciences sociales au prisme de l’extrême droite. Enjeux et usages d’une récupération idéologique, Paris, L’Harmattan, 2008, pp. 213-243.
[25] Stéphane François, L’Occultisme nazi, entre la SS et l’ésotérisme, Paris, CNRS éditions, 2020, pp. 150-155.
[26]Livre jaune n°6, Port Louis, Félix, 2001, pp. 241-276.
[27] Sa Doctrine secrète contient 313 fois le mot « dragon » et compte 456 occurrences du mot « serpent » ; le texte est disponible en ligne : https://ia600608.us.archive.org/21/items/DoctrineSecrteBlavatsky/doctrine%20secr%C3%A8te%20blavatsky.pdf (consulté le 9 janvier 2023).
[28] David Icke, Le plus grand secret, Saint-Zénon, Louise Courteau, 2001, pp. 363-387.
[29]Michael Barkun, A Culture of Conspiracy. Apocalyptic Visions in Contemporary America, Berkeley, University of California Press, 2003, pp. 122-123.
[30] Stéphane François, Au-delà des Vents du Nord. L’extrême droite française, le pôle Nord et les Indo-Européens, Lyon, Presses Universitaires de Lyon, 2014, p.15.
[31] Nicolas Lebourg, Les Nazis ont-ils survécu ?, Paris, Seuil, 2019 ; http://ordre-odiniste.blogspot.com/ (consulté le 14 décembre 2022).
[32] Maxime Courtin, Epistémologie du méta-complotisme de l’extrême droite française et internet, master 2, université de Nice Sophia Antipolis, 2020, pp. 105-107 ; Aurélien Montagner, Le Nationalisme conspirationniste soralien: Une idéologie radicale et marginale de l’extrême droite française contemporaine, thèse de doctorat, université de Bordeaux, 2020, pp. 567-568
[33] https://www.lemonde.fr/les-decodeurs/article/2020/12/09/silvano-trotta-figure-montante-d-un-complotisme-decomplexe_6062751_4355770.html (consulté le 30 janvier 2023)
[34] Wu Ming 1, Q comme Qomplot. Comment les fantasmes de complot défendent le système, Montréal, Lux, 2021, pp. 11-19.
[35] Cité dans https://hopenothate.org.uk/2018/03/27/hindu-mysticism-alt-right/ (consulté le 12 décembre 2022)
[36] Julius Evola, Révolte contre le mon moderne, Lausanne, L’Âge d’Homme, 1991 (première édition:1934).
[37] Alexandre Moatti, Alterscience. Postures, dogmes, idéologies, Paris, Odile Jacob, 2013.
[38]Johann Chapoutot,.« Comment meurt un Empire : le nazisme, l’Antiquité et le mythe », Revue historique, vol. 647, n° 3, 2008, pp. 657-676.
[39]Pierre Milza, « Le fascisme italien et la vision du futur », Vingtième Siècle, revue d’histoire, n°1, janvier 1984, pp. 47-56.
[40]Roger Griffin, « “I am no longer human. I am a Titan. A god !” The fascist quest to regenerate time », Electronic seminars in History, novembre 1998 (working paper).
[41] Jean-Loïc Le Quellec, « Une archéologie irrationnelle ? L’archéologie romantique », Stéphane François dir., Un XXIe siècle irrationnel ? Analyses pluridisciplinaires des pensées « alternatives ». Paris, CNRS Éditions, 2018, p. 101.
Le soft power, vous connaissez ?
Pas de fusil, pas de tanks. Juste des séries, des artistes, des festivals, des récits qui séduisent — et influencent profondément.
🎬Soft power : quand la culture devient stratégie.
À lire sur The ARTchemists : https://www.theartchemists.com/soft-power/
#softpower #culture #Géopolitique #influencer #BTS #bollywood #aiweiwei #diziturque #studioghibli #diplomatieculturelle #artetpolitique #TheARTchemists #culturepourtous
Quatrième édition du Nostre Mar Festival
https://vimeo.com/1089636084/f9ccce4b7d
Pour la quatrième année consécutive le festival Nostre Mar se déroule ce mois ce juin. Parmi les novations : il se passe désormais dans deux départements. Parmi les coutumes : on y croisera des contributeurs et amis de ce blog.
Nostre Mar est un festival cuturel et politique :
Un festival culturel méditerranéen
- Partager les arts et les savoirs.
- Découvrir l’unité et la diversité des sociétés méditerranéennes.
- Comprendre le passé, connaître le présent, construire l’avenir.
Un festival politique antiraciste
- Combattre le racisme, l’antisémitisme, la haine anti-LGBT et le sexisme.
- Déconstruire les stéréotypes.
- Construire un espace public non-polarisé
On retrouvera sur son site toutes les informations nécessaires.
Ci-dessous, la plaquette de son programme 2025 :
Le-programme-2025-de-Nostre-MarTéléchargerLe spectacle de Guillaume Meurice déprogrammé à Uccle par son bourgmestre Boris Dilliès !
#GuillaumeMeurice #LibertéDExpression #Censure #Uccle #BorisDilliès #HumourEngagé #SatirePolitique #LefrancMatombé #StandUp #Belgique #RésistanceCulturelle #Meurice #FachoStop #PolitiquementIncorrect #ArtEtPolitique
Quand « se faire justice » dépend de son genre
Charles Bronson dans Un justicier dans la ville (Death Wish, Michael Winner, 1974) et Betsy Palmer dans Vendredi 13 (Friday the 13th, Sean S. Cunningham, 1980)Par Marc Gauchée
En 1974 avec Un justicier dans la ville (Death Wish, Michael Winner), Charles Bronson inaugure une série de films où il incarne un architecte, Paul Kersey, qui passe ses nuits à traquer et à éliminer les criminels qui s’en sont pris à ses proches. C’est ainsi qu’il tue les violeurs et assassins de sa femme (Hope Lange) et les agresseurs de sa fille (Kathleen Tolan) dans Un justicier dans la ville ; les violeurs et assassins de sa fille (Robin Sherwood) et de Rosaria (Silvana Gallardo), sa gouvernante, dans Un justicier dans la ville 2 (Death Wish 2, Michael Winner, 1982) ; les trafiquants de drogue responsables de la mort d’Erica (Dana Barron), la fille de sa nouvelle compagne dans Le Justicier braque les dealers (Death Wish 4: The Crackdown, J. Lee Thompson, 1987) et l’assassin d’Olivia (Lesley-Anne Down) sa nouvelle (nouvelle) compagne dans Le Justicier : L’Ultime combat (Death Wish 5: The Face of Death, Allan A. Goldstein, 1994). La version féminine figure dans un film de 1980 qui donne également lieu à une série : Betsy Palmer incarne Pamela Voorhees, une mère de famille dans Vendredi 13 (Friday the 13th, Sean S. Cunningham) qui se « fait justice » en éliminant toutes celles et ceux qui fréquentent le camp de vacances de Crystal Lake où s’est noyé son fils il y a vingt ans. Vendredi 13 connaît 11 autres films, jusqu’en 2009.
Le père, ce héros
Même s’il ne fait pas bon être la conjointe de Paul, et même si ce dernier n’est pas un père qui arrive à protéger sa famille décimée à chaque nouvel opus de la saga, le protagoniste de la série du Justicier parvient toujours à retrouver les responsables des crimes et les exécute sans commettre de bavures, ni se tromper de cible. Il est bien un héros, comme le cow-boy solitaire des westerns qui vient rétablir l’ordre dans l’Ouest sauvage à coups de pistolet. Ses meurtres obéissent à une certaine rationalité, ancrée dans une idéologie de l’autodéfense et une mise en œuvre du droit des citoyens à se défendre sous couvert d’une lecture très « républicaine » du deuxième amendement de la Constitution américaine (1791) : « Une milice bien organisée étant nécessaire à la sécurité d’un État libre, il ne sera pas porté atteinte au droit du peuple de détenir et de porter des armes ». D’autant plus que Paul se retrouve face à une police et une justice présentées comme corrompues, trop procédurières, incompétentes ou inefficaces. Il est bien cet homme et ce père blessé et meurtri.
La mère, cette folle
En revanche, s’il y a aussi beaucoup de meurtres dans Vendredi 13 et s’il y a aussi un parent dévasté par la mort de son enfant, en passant du père à la mère, la psychopathe a remplacé le justicier et les meurtres en série ont succédé aux meurtres ciblés. Pour Pamela, son fils s’est noyé faute de surveillance par les monitrices et moniteurs et cela justifie son entreprise meurtrière qui transforme le camp de Crystal Lake en lieu maudit. Dans Vendredi 13, toute l’équipe qui entreprenait de rouvrir le camp est décimée par Pamela. La folie de Pamela ne fait aucun doute : elle est véritablement possédée par son fils puisqu’elle prend sa voix lorsqu’elle tente d’occire Alice Hardy (Adrienne King), la dernière monitrice survivante : « Tue-la, maman ! ». D’ailleurs, elle finit par perdre réellement la tête puisqu’Alice la décapite d’un coup de machette. À la différence de Paul, Pamela tue des innocents et sa folie meurtrière n’a pas de fin.
Les autres films qui suivent Vendredi 13 ne mettent plus en scène Pamela, éliminée, mais son fils qui ne s’est finalement pas noyé, mais a survécu dans les bois et poursuit l’œuvre macabre de sa mère… Même le motif de la vengeance de la mère est donc disqualifié ! En revanche, dès le deuxième opus de la série (Vendredi 13 : Chapitre 2 de Steve Miner, 1981), Jason, lui, sait se venger du meurtre de sa mère et tue Alice ! Que ce soit dans la série du Justicier comme dans celle de Vendredi 13, ce sont toujours les jeunes femmes qui sont poursuivies, subissant agressions, viols jusqu’à l’assassinat.
Les jeunes femmes, ces victimes
Ces jeunes femmes victimes ont une longue histoire dans le cinéma américain. Cet archétype de personnage a été surnommé scream queen (« reine du cri ») par un jeu de mots sur l’expression initiale screen queen (« reine de l’écran »). La future victime est effrayée par son pourchasseur (avant d’être rattrapée) et pousse donc de nombreux cris stridents. La première scream queen fut Fay Wray dans King Kong (Merian C. Cooper et Ernest B. Schoedsack, 1933) … capturée par un immense gorille amoureux d’elle.
Dans les années 1970 et 1980, les scream queens ne sont pas seulement violentées, elles sont tuées comme pour distiller l’idée qu’il est toujours dangereux pour une jeune femme de s’aventurer dans l’espace public ou de rester seule sans un mâle protecteur. Des films français en mal d’audience dupliquent d’ailleurs ce schéma narratif. Parole de flic (José Pinheiro, 1984) reprend la trame d’Un justicier dans la ville, puisque l’ancien policier Daniel (Alain Delon) s’est retiré en Afrique à la suite du non-lieu dont a bénéficié le meurtrier de sa femme et c’est l’assassinat de sa fille Mylène (Aurélie Doazan) qui le fait revenir en France pour traquer les coupables. Dans L’Exécutrice (Michel Caputo, 1986), l’inspectrice de police Martine (Brigitte Lahaie) ne peut empêcher l’assassinat de sa jeune sœur enlevée par des proxénètes.
Une mère présentée comme hystérique et schizophrène, là où le père est méthodique et rationnel. Quant aux jeunes femmes, elles sont maintenues à leur place par la peur. Tout le monde est ainsi assigné aux pires stéréotypes de son genre.
Rap et antimaçonnisme
Première parution : Stéphane François, « Rap et antimaçonnisme, étude d’un cas français ». La chaîne d’union, vol. 108, n°2, 2024. pp. 95-101.
La franc-maçonnerie continue de nourrir les fantasmes d’une population étrangère au monde dans lequel elle s’inscrit : en effet, il suffit de discuter avec des « jeunes » (adolescents ou jeunes adultes) pour se rendre compte de la césure culturelle existant avec leurs aînés. Peu d’entre eux possèdent des références culturelles dépassant leur génération… Pourtant, l’antimaçonnisme reste présent, avec des argumentaires assez similaires à ceux de leurs aînés, avec des arguments similaires à ceux que l’extrême droite utilise depuis la fin du XIXe et le début du siècle suivant. Une question s’impose : s’agit-il d’un phénomène nouveau, similaire, ou sommes-nous confrontés à la persistance des vieilles antiennes de l’antimaçonnisme « classique », sous de nouveaux apparats ? Nous verrons que l’antimaçonnisme de cette génération se nourrit à la fois d’éléments provenant d’une certaine culture marginale issue de leur génération, qui elle-même s’alimente à des sources plus anciennes.
Freeze Corleone, un rappeur abscons, mais explicite
Pour se faire, nous nous intéresserons au cas de Freeze Corleone (pseudonyme d’Issa Lorenzo Diakhaté), un rappeur français. Il est une figure à part dans l’univers du rap francophone. Distant, il ne donne pas d’entretien et se place à la marge du rap français. Celui-ci est né en France le 6 juin 1992 aux Lilas, mais vivant au Sénégal, a provoqué une polémique en septembre 2020 quelques jours après la sortie de l’album, LMF (pour La Menace Fantôme). Il était accusé par la LICRA d’être ouvertement antisémite et de jouer avec les codes du néonazisme. Cette construction intellectuelle est noyée chez ce rappeur dans une masse de références à la pop-culture et aux contre-cultures telles que Star Wars ou l’univers des super héros (Marvel ou DC Comics), le tout énoncé dans un langage volontairement abscons et mâtiné d’une forme d’afrocentrisme ésotérisant, le kémitisme. Ses textes sont aussi influencés par un antimaçonnisme typique de l’extrême droite.
LMF, paru en 2020, est son premier album sorti en CD et distribué par Universal Music France, dans lequel on retrouve ses obsessions, déjà présentes sur ses précédentes productions, numériques celles-ci : le complotisme, l’ésotérisme, les contre-cultures et les juifs. Mais, confinées à des sphères contre-culturelles, elles ne provoquèrent aucune réaction.
Succès commercial dès les premiers jours, l’album a été défendu par des journalistes et des rappeurs qui ont cherché à minimiser le caractère délictueux de son contenu. Selon ces derniers, il aurait fallu voir en priorité la qualité artistique, incontestable, des productions du rappeur. La provocation est d’ailleurs la marque de fabrique de ce rappeur : l’album LMF dont la mise en ligne était prévue le 7 janvier 2020 a été décalée au 11 septembre 2020 (pour le 11 septembre 2001), et l’album numérique Projet Blue Beam a lui été mis en téléchargement le 13 novembre 2018 (date anniversaire des attentats du 13 novembre 2015).
Une scène rap atteinte de complotisme
Une frange du rap, parmi la plus underground, joue un rôle important dans la diffusion des thèses complotistes et/ou antisémites auprès d’une population relativement jeune et souvent immature idéologiquement, contrairement à d’autres scènes musicales « engagées ». Pour s’en convaincre, il suffit de regarder le nombre de vues sur youtube de certains groupes de rap. Sa tendance la plus contre-culturelle véhicule en effet un discours diffus, empreint de complotisme (Nekfeu, El Matador, Keny Arkana, etc. pour ne prendre que des exemples français) et parfois d’antisémitisme (comme le rappeur Wiley au Royaume-Uni, Kholardi en Norvège, Bissy Owa en Belgique, etc.). Ce registre musical, né dans les ghettos afro-américains états-uniens, a gardé auprès des adolescents et de jeunes adultes l’image d’une scène subversive, bien que les rappeurs, malgré leur image de « mauvais garçons » encore mise en avant aujourd’hui, soient surtout des hommes d’affaires qui gèrent très bien leur image. Comme le rap s’est « normalisé » dans les années 1990, certains musiciens, désirant garder cet aspect subversif, ont dû radicaliser leur discours, souvent dans un sens complotiste. Ainsi, nous trouvons régulièrement dans la frange la plus underground du rap des critiques de la franc-maçonnerie, des Illuminatis, des reptiliens, des satanistes etc. qui contrôlerait les esprits et le monde « Big Pharma » (« j’suis dans le complot comme Big Pharma », titre éponyme présent sur l’album LMF)…
Projet Blue Beam Intro est l’album par lequel la polémique est arrivée. Nous y trouvons le « franc-maçon », forcément synonyme de « puissant », de « gouvernant », le « juif » (la référence implicite au « complot judéo-maçonnique » est fréquente chez ce rappeur), protégé par une supposée impunité, ou la condamnation des « sociétés secrètes » :
« Tes fausses merdes sont seulement dorées
J’avance avec mes frères
Comme un franc-maçon
Mon âme pour du cash ou des ’tasses
Merci sans façon »
(JPMA pour « J’vendrai pas mon âme »)
En outre, les références à la famille Rothschild sont omniprésentes chez Freeze Corleone, qu’il associe inévitablement aux Illuminati, au groupe Bilderberg et à Rockfeller, une incontournable triade chez les conspirationnistes. De fait, la référence implicite au « complot judéo-maçonnique » de la première moitié du XXe siècle est fréquente chez ce rappeur, reprenant de vieilles antiennes de l’extrême droite complotiste, diffusées en France par Henry Coston. Les similitudes sont d’ailleurs frappantes : comme chez Coston, le « franc-maçon », chez Corleone, est forcément juif. Il manipule dans l’ombre, intouchable et riche. Les deux reprennent de façon systématique les poncifs sur la famille Rothschild. Dans une étude sur l’antimaçonnisme dans le rap, Julien Montassier explique que
« le franc-maçon est aussi Illuminati, reptilien, sataniste, il gouverne le monde, contrôle les esprits via “Big Pharma” ou les “chemtrails”, décime l’Afrique avec le SIDA et Ebola, fomente des attentats, persécute les Catholiques, persécute les Musulmans […] Le franc-maçon est la source de tous les maux et le coupable de tous les crimes, sans n’avoir pourtant à rendre des comptes à quiconque.[1] »
Nous sommes manifestement dans un discours anti judéo-maçonnique identique à celui des complotistes d’extrême droite, enrichi néanmoins de quelques nouvelles thématiques. À l’exception de ces références, la structure antimaçonnique reste similaire : les francs-maçons, société secrète tentaculaire, sont là pour détruire les nations et les fondements religieux ou traditionnels des sociétés. Barruel a la vie dure.
En outre, tous ces rappeurs se présentent comme des adeptes de la « réinformation »[2] et cherchent à prouver l’existence d’une « oligarchie » manipulant une « démocratie fasciste » (sic), pour reprendre des expressions utilisées par Rockin’Squat (alias Mathias Crochon, le frère de Vincent Cassel et le fils de Jean-Pierre Cassel), ancien du groupe Assassin, dans le titre « Démocratie fasciste article 3 ». Positionné politiquement à gauche initialement, celui-ci a glissé progressivement vers le conspirationnisme, au point de devenir un soutien de l’activiste afrocentriste et antisémite Kemi Seba. Le titre « Illuminazi 666 » (2009), reprenant le terme « Illuminazi » au journaliste complotiste américain Anthony Hilder en est un exemple. Son texte explique que les populations sont soumises à une politique de désinformation orchestrée par la mythique société secrète des Illuminati. Le rappeur incite évidemment son auditoire à ouvrir les yeux. Il se définit comme un rappeur « conscient ». D’autres rappeurs, tels Mysa, associent complotisme, antisémitisme et défense de l’islam ; en 2007, ce dernier chante dans son album « Le cercle » :
« Illuminati, Nouvel Ordre Mondial, franc-maçon ou sioniste/
La même merde et pour l’information on s’enlise dans le chaotique ».
L’essor de la thématique complotiste chez les rappeurs francophones est lié à un mouvement plus profond, venant des États-Unis. Ainsi, le groupe Army of Pharaoh a été l’un des premiers à développer cette thématique autour des années 2005-2010. Freeze Corleone reprend cet héritage. À ce titre, le chanson « Bâton rouge » est explicite :
« Fuck un Rothschild, fuck un Rockfeller/[…]
L’objectif se rapproche
J’arrive déterminé comme Adolf dans les années 30 »
(Bâton rouge)
Freeze Corleone y développe en outre d’autres thèmes conspirationnistes, présents également chez les théoriciens actuels de l’« État profond » – une thématique devenue célèbre grâce aux militants de la mouvance Qanon. Nous retrouvons logiquement chez lui des mots-valises issus du complotisme américain comme « MK Ultra » ou « HAARP ». Le premier était un projet des années 1970 de la CIA sur l’utilisation de drogues hallucinogènes (LSD) et de la manipulation mentale dans le cadre d’activités subversives ; le second, High Frequency Active Auroral Research Program, était un programme d’étude de l’ionosphère. Les complotistes en ont fait un programme de manipulation à la fois du climat et des ondes hertziennes par une officine secrète… En bon observateur de la contre-culture américaine, il reprend également des thématiques venant de l’ufologie, autre milieu particulièrement complotiste. Ainsi, Projet Blue Beam Intro est une référence explicite au « Project Blue Book », un programme d’enquête sur les ovnis mené par l’US Air Force de 1952 à 1969, qui fit fantasmer les ufologues complotistes américains et qui entre aujourd’hui en résonance avec la notion d’« État profond ».
Les Juifs, toujours les Juifs
Enfin, il n’hésite pas à rapper son négationnisme « Tous les jours R à F [rien à foutre] de la Shoah » dans S/O Congo, un titre portant sur la traite négrière, qui développe l’idée d’une concurrence des mémoires, qu’on retrouve au cœur de l’évolution de Dieudonné : l’esclavage et la déportation des populations africaines n’intéresseraient pas les Occidentaux au contraire de la Shoah. S’il ne cite pas les négationnistes les plus connus, le mélange contre-culture/négationnisme/complotisme présent dans ses textes est un marqueur précis, qui renvoie aux livres de l’ufologue complotiste négationniste allemand Jan Udo Holey, connu sous le pseudonyme de Jan Van Helsing, célèbre pour la série des « Livres Jaunes » (clin d’œil à l’ufologie complotiste), aux contenus à la fois contre-culturels, antisémites et négationnistes. Corleone lui dédie d’ailleurs un titre en 2019, « Livre Jaune 1 à 7, S/o Van Helsing », sur Niribu, un album d’Osirus Jack.
Le mélange qui résulte de cette vision du monde, distillé dans des chansons aux accents mystérieux pour un public jeune, associe donc bel et bien contre-culture, antisémitisme, négationnisme, extraterrestres et complotisme. Nulle référence à la religion musulmane dans ce vertigineux kaléidoscope, contrairement à ce qu’ont pu affirmer certains experts médiatiques.
Nous pourrions penser qu’une telle logorrhée ferait figure d’exception, mais ce n’est pas le cas dans la scène rap. L’essor de discours de ce type chez les rappeurs francophones est particulièrement inquiétant, car il diffuse massivement chez les amateurs de rap, peu au fait des subtilités rhétoriques de leurs artistes préférés et de leurs discours ouvertement connotés idéologiquement. Cela est d’autant plus inquiétant que ce type de discours se multiplie depuis une dizaine d’années et surtout que peu de groupes sont punis par la loi. Mais il est vrai que les scènes contre-culturelles, difficiles d’approche passent souvent sous les radars de la justice. L’essor de ces thématiques complotistes et antisémites est lié aussi à l’argent généré. Ce registre musical est devenu une industrie prospère vendant énormément, et, par conséquent, diffusant massivement ses messages nauséabonds.
Comme nous avons pu le constater avec le cas de Freeze Corleone, l’antimaçonnisme contemporain se nourrit de différents discours, aux origines diverses. À l’instar de ses aînés, son antimaçonnisme est lié à une conception conspirationniste du monde et sur une vision erronée de la franc-maçonnerie. Il la voit comme une société secrète nocive, mais sans qu’il puisse donner de détails plus précis, reprenant les schèmes classiques de l’antimaçonnisme : société secrète à contenu magique – souvent satanique – ; société secrète composée de personnes à la moralité douteuse, attirées par l’appât du gain ; groupe politique secret dirigeant le monde, etc. La critique reste donc au niveau d’une généralité, presque métaphysique, se confondant avec les Illuminati. Pour relativiser un peu ce propos, nous devons reconnaître que cette méconnaissance et cette vision erronée étaient quasiment les mêmes au XIXe siècle.
Alors, sommes-nous en face d’une nouvelle forme d’antimaçonnisme ? Nous pensons, au vu des matériaux et des thèmes mobilisés par ce rappeur, que nous sommes plutôt en présence du même antimaçonnisme qu’aux XIXe et début du XXe siècles, noyé dans une masse de références contre-culturelles. En effet, de nouvelles thématiques ne sont pas apparues, à l’exception de la référence aux Illuminati, mais celle-ci a été forgée à partir de vieux matériaux complotistes (la franc-maçonnerie comme société secrète satanique, comme société clientéliste et élitiste, comme groupe antireligieux, voire pédophile, etc.).
[1] Cité in Olivier Dard, « De l’ancien au nouveau ? Facette de l’antimaçonnisme français contemporain », in Jean-Philippe Schreiber (dir.), Les Formes contemporaines de l’antimaçonnisme, Bruxelles, Éditions de l’Université Libre de Bruxelles, 2019, p. 49.
[2] Le terme de « réinformation » est une notion utilisée par l’extrême droite, puis par les complotistes, depuis les années 2000, qui se présente comme une « alternative » au contenu des « médias officiels », forcément mensongers. Concrètement, il s’agit de promouvoir une « contre-information » qui ne serait pas manipulée par « le politiquement correct » ou les gouvernements. La « réinformation », par certains aspects, en particulier par les stratégies utilisées, est proche de la désinformation et de la propagande idéologique.
Exposition sur l'art dégénéré au Musée Picasso Paris : une immersion intense dans la persécution de l'art moderne sous le nazisme.
Ne manquez cette exposition incontournable sous aucun prétexte !
#artdégénéré #exposition #histoiredelart #LibertéArtistique #artetpolitique
#artmoderne #nazisme #picasso #artcontemporain #modernart #expositionparis #contrelefascisme #résistanceparlart #artetsociété
De porte en porte raconte l’expérience de travailleur·euse·s essentiel·le·s au Québec par une série de portraits environnementaux argentiques de format moyen, réalisés en noir et blanc. Le projet explore les thèmes de la charge mentale, du travail affectif et des effets du travail sur le corps.
Exposition de Selena Phillips-Boyle. Vernissage :
Date : le 27 avril
Heure : de 13 h à 15 h
Histoire et mythe conspirationniste du mot « islamophobie »
Xénophile et xénophobe sont construits sur xéno- (grec ξενο-), de xénos « étranger » (ξένoς), avec les éléments -phile provenant de phílos (φίλος) « ami » et -phobe, de phóbos (φόβος) « peur ». Sera donc xénophile toute personne témoignant de la sympathie pour les étrangers, et xénophobe celle montrant pour eux une aversion instinctive, voire, par extension de sens, une hostilité. La première attestation de « xénophobie » remonte à 1906, et celle de « xénophilie » à l’année suivante1.
Si l’on examine l’emploi de ces deux termes en France, il est frappant de constater que « xénophobe » a commencé d’être utilisé à la toute fin du xixe siècle, puis a connu deux moments de croissance rapide après les guerres de 1914-1918 et de 1939-1945, avec un premier pic en 1925, et un second en 1954. Depuis 1965, le taux d’usage du terme s’est accru de façon régulière, alors que « xénophile » est toujours aussi peu employé.
Graphique Ngram des taux d’usage de « xénophile » et « xénophobe » en français depuis 1800.
Une évolution comparable peut s’observer pour les mots « islamophobe » et « islamophile », d’origine un peu plus récente, puisque tous deux n’apparaissent qu’à partir de 1910.
Graphique Ngram des taux d’usage de « islamophobie » et « islamophilie » en français depuis 1910.
Des polémiques se sont récemment élevées — et se poursuivent toujours — à propos du terme « islamophobie », notamment depuis une chronique signée en 2003 par Caroline Fourest et Fiammetta Venner qui, dans leur revue ProChoix, ont prétendu qu’il aurait « pour la première fois été utilisé en 1979, par les mollahs iraniens qui souhaitaient faire passer les femmes qui refusaient de porter le voile pour de ‟mauvaises musulmanes” en les accusant d’être ‟islamophobes” »2. Employer ce mot serait donc tomber dans un piège assez grossier, selon une opinion reprise en 2010 par Pascal Bruckner, qui proposa de le « bannir d’urgence du vocabulaire » car il aurait été « forgé par les intégristes iraniens à la fin des années 70 pour contrer les féministes américaines ». Il ajoutait que la fonction de « cette création digne des propagandes totalitaires » serait « de faire de l’islam un objet intouchable sous peine d’être accusé de racisme »3. Ces auteurs réactivaient l’épouvantail rhétorique utilisé en 2002 par Pierre-André Taguieff qui déclarait que « par l’effet d’une extension abusive de la vigilance antiraciste, toute critique de l’intégrisme islamique est immédiatement dénoncée comme manifestation d’islamophobie. Le terrorisme intellectuel règne »4. En juillet 2013, Manuel Valls, alors ministre de l’Intérieur reprenait à son compte cet argumentaire erroné: « derrière le mot ‟islamophobie”, il faut voir ce qui se cache. Sa genèse montre qu’il a été forgé par les intégristes iraniens à la fin des années 1970 pour jeter l’opprobre sur les femmes qui se refusaient à porter le voile. Je crois que Caroline Fourest et avec elle d’autres intellectuels ont raison […] Pour les salafistes, ‟[l’]islamophobie” est un cheval de Troie qui vise à déstabiliser le pacte républicain »5. L’argument fut repris en 2014 dans une lettre ouverte à Najat Vallaud-Belkacem, ministre de l’Éducation nationale6, puis en 2015 par Patrick Kessel qui, lors la remise du Prix de la Laïcité, dénonça « ce concept sournois d’‟islamophobie” qui vise à condamner comme raciste toute critique de l’islam radical »7. Il le fut encore en 2016 par Elisabeth Badinter qui, un an après l’attentat de Charlie Hebdo a déclaré sur la matinale de France-Inter: « il faut s’accrocher et il ne faut pas avoir peur de se faire traiter d’islamophobe »8.
Régis Debray ajouta peu de temps après que « le chantage à l’islamophobie est insupportable »9, et en mai 2016, Gilles Kepel, professeur à Sciences Po, affirmait, contre toute évidence: « Le mot est apparu en France dans les années 2000, dix ans après son apparition en Grande-Bretagne, dans la foulée de l’affaire Rushdie. Ce n’est pas un concept, c’est une fabrication destinée à interdire le débat, une arme dans la guerre intellectuelle. L’accusation d’islamophobie sert à interdire toute critique de la salafisation d’une partie des banlieues »10. Il récidiva en compagnie d’un autre professeur de Sciences Po, Bernard Rougier, déclarant que « ‟radicalisation” comme ‟islamophobie” constituent des mots écrans qui obnubilent notre recherche en sciences humaines »11.
Cette dernière remarque est proprement sidérante au vu du nombre considérable des travaux consacrés à l’islamophobie. En 2006, Chris Allen lui a consacré une thèse qui fut publiée en 201012; en 2006 également, la Fondation de la Maison des Sciences de l’Homme a organisé à Paris un colloque international sur le thème de « L’islamophobie dans le monde moderne »; Abdellali Hajjat et Marwan Mohammed ont mis en place en 2011 un séminaire sur l’islamophobie à l’École des Hautes Études en Sciences Sociales, Fernando Bravo López a soutenu une thèse sur le même sujet en 201213, qui est aussi l’année de la création de la revue Islamophobia Studies. Il est vrai que la recherche en ce domaine, du côté français, a longtemps été à la remorque des travaux anglo-saxons, mais le jugement infondé d’universitaires comme Gilles Kepel et Bernard Rougier ne contribue guère à faire avancer les choses14.
Par ailleurs, répéter sans réfléchir, à l’instar de Michel Onfray, que le terme islamophobie « est un mot inventé par l’Iran de Khomeiny pour stigmatiser tout opposant à son régime »15 est doublement faux.
Premièrement, Alain Quellien l’utilisait déjà dans sa thèse publiée en 1910, dans laquelle il définissait « l’islamophobie » comme « un préjugé contre l’Islam répandu chez les peuples de civilisation occidentale et chrétienne »16. En lisant, entre autres « classiques » de la littérature coloniale, les œuvres de Joseph du Sorbiers de la Tourasse ou du Dr Oskar Lenz, il ne pouvait que constater que « pour d’aucuns, le musulman est l’ennemi naturel et irréconciliable du chrétien et de l’Européen, [que] l’islamisme est la négation de la civilisation [et que] la mauvaise foi et la cruauté sont tout ce qu’on peut attendre de mieux des mahométans »17. C’est cette attitude qu’il dénommait « islamophobie ».
Deuxièmement, il n’existe aucun équivalent iranien à ce terme. En persan, on pourrait à la rigueur dire islām harāsī (اسلام هراسی), littéralement « hostilité à l’islam », tout comme en arabe on dirait ‛adā’ al-islām (عداء الاسلام), mais en réalité, ce terme est bien une invention française qui, pour être rendue en arabe, a donné lieu dans les années 1990 à la création de l’expression ruhāb al-islām (رهاب الاسلام) « phobie de l’islam ». Sa première apparition en anglais date de 1924, mais elle figure au titre de citation dans la recension d’un livre cosigné par Sliman Ben Ibrahim et le peintre orientaliste Étienne Dinet, et ce mot, alors simplement cité, n’a pas été adopté en anglais à cette époque: on lui a préféré l’expression feelings inimical to Islam (« sentiments hostiles à l’Islam »). On notera la majuscule à Islam, faisant que ce mot désigne alors l’ensemble du monde musulman, et non une religion particulière18. Dinet et Ben Ibrahim ne donnaient pas de définition explicite de ce qu’ils entendaient par « islamophobie », mais leurs écrits montrent à l’envi qu’ils désignaient ainsi une attitude hostile à l’islam, regardé comme un ennemi à combattre ou à éliminer19.
Selon le Grand Dictionnaire d’Oxford, l’apparition d’islamophobia en anglais ne survient qu’en 1976 dans un article de Georges Chahati Anawati affirmant que « ce qui rend la tâche difficile, et peut-être impossible, pour un non-musulman, c’est que, sous peine d’être accusé d’islamophobie, il est obligé d’admirer le Coran dans sa totalité et de se garder de laisser supposer la moindre critique sur la valeur littéraire de ce texte »20. Cet islamologue égyptien appartenant à l’ordre des Frères Prêcheurs introduisit dans son texte une modification de sens, et même un véritable retournement: pour Étienne Dinet et Sliman Ben Ibrahim, l’islamophobie ne désignait que les préjugés des orientalistes à l’égard des musulmans, mais sous la plume d’Anawati apparaît une nouvelle acception, puisque par ce même terme il vise désormais le préjugé musulman consistant à s’opposer à toute critique textuelle du Coran qui serait l’œuvre d’analystes non-musulmans21. C’est là, vraisemblablement, l’origine de l’idée fausse selon laquelle il s’agirait d’un mot créé pour opérer un véritable chantage en direction des critiques occidentaux.
Affirmer que le concept d’islamophobie aurait été inventé pour limiter la possibilité de critiquer l’islam comme religion, et qu’en conséquence il ne faudrait pas craindre de se faire traiter d’islamophobe, c’est ne retenir qu’une instrumentalisation partisane du terme. Semblablement, que l’accusation d’antisémitisme soit régulièrement lancée aux critiques de la politique d’Israël n’implique pas que ce terme serait vide de sens, que l’antisémitisme n’existerait pas et qu’il conviendrait d’abandonner ce mot.
Certains, considérant que le suffixe « phobie » renvoie étymologiquement à la peur, en ont conclu qu’en toute logique l’islamophobie devrait désigner une aversion irraisonnée, une peur pathologique, tout comme l’agoraphobie est la peur pathologique des espaces vides et la claustrophobie celle des espaces confinés. Son emploi relèverait donc d’une sorte de médicalisation outrancière de notre société, dont témoigne l’avalanche de termes récemment construits sur le même modèle: ablutophobie (peur de se baigner), achluophobie ou nyctophobie (peur du noir), émétophobie (peur de vomir), éreutophobie (peur de rougir en public), géphyrophobie (peur de traverser les ponts), haptophobie (peur d’être touché), leucosélophobie (peur de la page blanche chez les écrivains), ochlophobie (peur de la foule) et autre apopathodiaphulatophobie (peur d’être constipé). Selon cette façon de voir, souvent relayée par les sites d’extrême droite, l’islamophobie serait de la même famille que la cynophobie (peur des chiens), l’ailurophobie (peur des chats), l’ornithophobie (peur des oiseaux), l’arachnophobie (peur des araignées), la musophobie (peur des souris), l’ophiophobie ou herpétophobie (peur des serpents). Or aucune de ces affections n’étant un racisme, aucune d’elle ne correspondant à une revendication, il devrait en être de même de l’islamophobie22.
Bref: on ne saurait en vouloir aux islamophobes, qui seraient simplement atteints d’une maladie bénigne. Une telle façon de pratiquer l’étymologie est inacceptable, car elle revient à considérer un terme en se fondant seulement sur l’analyse (correcte ou non) de son origine, sans prendre en compte l’histoire de son usage. Ainsi que le remarque Nicolas Lebourg, si l’on devait adopter ce type d’approche, « les sciences sociales devraient donc également s’épurer des mots ‟nationalisme”, ‟antisémitisme”, ‟racisme”, ‟néo-racisme” et ‟racialisme” »23.
Le psychanalyste Daniel Sibony a soutenu que la notion d’islamophobie tendrait effectivement à imposer l’idée d’une « peur de l’islam », mais que cette signification se serait vite étiolée au profit de celle de « peur de dire ou de laisser dire des choses dont on pense qu’elles pourraient contrarier les musulmans ». Ce nouveau retournement de sens lui fut inspiré par une approche historique faisant bien peu de cas des faits: « Précisons — a-t-il écrit en effet — que le terme ‟islamophobie” […] a été lancé à la suite du 11 septembre 2001 dans un effet de propagande: des gens étaient effrayés par l’aspect sans ‟limite” de cet acte, et l’effroi inspiré par les terroristes a été orienté, grâce à ce mot, vers l’islam tout entier, comme si on voulait que toute inquiétude sur des attentats soit pointée comme une angoisse sur tout l’islam. C’était aussi une façon de protéger les auteurs de l’attentat, qu’on admirait: grâce à ce mot, les trouver haïssables et prendre au sérieux leur propos, c’était haïr tout l’islam »24.
Il serait légitime de s’interroger sur l’identité du « on » dont parle cet auteur, mais pour juger de la fausseté de son argumentaire, il suffira de le rapporter au graphique montrant le taux d’usage du mot islamophobia en anglais américain entre 1990 et 2008 (le logiciel Ngram ne permet pas de tenir compte des années plus récentes). Ce graphique prouve que, contrairement à ce qu’affirme Daniel Sibony qui ne citait aucune donnée concrète, l’usage de ce mot a commencé à « décoller » à partir de 1996, qu’il s’est nettement ralenti de 2001 à 2002 pour croître de nouveau ensuite, beaucoup plus rapidement depuis 2006. Rien ne confirme donc l’effet de « lancement » que Daniel Sibony signale à partir de septembre 2001, et qui n’a jamais existé que dans son imagination. Les historiens ont du reste démontré qu’à cet égard, « le 11 septembre 2001 ne représente pas une rupture réelle, et s’inscrit plutôt dans une continuité historique »25.
Graphique Ngram des taux d’usage de « islamophobia » en anglais américain entre 1990 et 2008.
S’il fallait considérer l’augmentation de la fréquence de ce terme comme la conséquence d’un événement politique de portée internationale, c’est plutôt dans la guerre du golfe et l’opération « Tempête du Désert », en 1990-1991 qu’il faudrait chercher celui-ci, et non dans les attentats de septembre 2001.
Plusieurs adeptes de l’hypercorrection linguistique, dont encore Daniel Sibony, soutiennent que « le mot phobie est bizarrement utilisé dans des termes comme homophobie, xénophobie, judéophobie, islamophobie, américanophobie… La bizarrerie consiste à mettre ‟phobie” chaque fois qu’on n’aime pas une chose ». Il est alors facile d’ajouter qu’on ne peut interdire à quelqu’un d’avoir peur, et qu’il serait donc absurde de considérer l’islamophobie comme un comportement répréhensible26.
C’est oublier trois choses essentielles.
Premièrement, « phobie » peut se traduire par « horreur »: Littré glose « hydrophobe » par « qui a horreur de l’eau », et le glissement de l’horreur à la haine relève de l’évidence. Le Dictionnaire Quillet traduit phobie par « crainte ou haine » et le Grand Robert lui reconnaît les synonymes suivants: « peur, crainte, aversion, dégoût, horreur, terreur, haine ».
Deuxièmement, la langue ne fonctionne pas comme un jeu de meccano permettant de construire automatiquement des mots sur la seule base de règles strictement logiques. Le coton hydrophile est-il un « ami » de l’eau? Si un cartophile est un collectionneur de cartes postales, un pédophile est-il un collectionneur d’enfants? Un homophobe est-il quelqu’un qui n’aime pas la similitude?
Troisièmemement, le néologisme « xénophobe » ne se comprend pas moins comme l’appellation générique d’une série pré-existante, puisque les mots « anglophobe » et « francophobe » existaient depuis le xixe siècle. Que le modèle de cette série soit effectivement productif se vérifie avec l’apparition de « germanophobe » au siècle suivant, par exemple sous la plume de Proust en 192227. Dès lors « islamophobe » n’est qu’un exemple parmi d’autres de cette productivité, puisque le suffixe « phobe / phobie » peut s’utiliser pour construire des mots désignant la détestation d’un peuple particulier28 ou d’une religion donnée. Sur internet, on trouve ainsi « hispanophobe », « italophobe », « nipponophobe »… et la Reconquista espagnole a été considérée comme une « maurophobie »29, ce qui, pour Javier Rosón Lorente, donne à l’islamophobie en Espagne un petit air de « déjà-vu »30. De même, la fixation des débats sur le voile dit « islamique » en France a motivé la création du terme « hijabophobie »31, et l’on parle aussi de LGBTphobie (LGBT: « lesbiennes, bays, bisexuels et transgenres »).
La liste continue de s’allonger avec « bouddhophobie » et « christianophobie » ou « christophobie », formés après « judéophobie », créé par Leon Pinsker en 1882, sous la forme allemande Judophobie, ensuite francisée32. Ilan Halevi est donc fondé à écrire que l’islamophobie ressemble fort à la judéophobie et que « toute tentative de se mesurer à l’une sans prendre l’autre à bras-le-corps est par définition futile, car l’islamophobie, sous-catégorie du racisme en général, apparaît dans la nature sociale comme une métastase de l’antisémitisme »33. Une bonne partie des argumentaires islamophobes et judéophobes s’appuie sur la dénonciation du Coran et de la Bible comme autant d’appels au meurtre, suivant une démarche qui se limite à rechercher dans ces textes la cause ultime du « terrorisme islamique » actuel34, comme si les jihadistes étaient des maniaques de l’exégèse, des érudits passionnés par la pratique du commentaire théologique. Dans le cadre de l’exercice consistant à s’envoyer à la figure des citations extraites de leur contexte, on pourrait bien dire: « salafistes et Onfray, même combat! »35
Dans la même logique qui avait conduit à la formation de « xénophobie », Vincent Geisser a donc créé le genérique « religiophobie ». Pour lui, « l’islamophobie n’est pas simplement une transposition du racisme anti‑arabe, anti‑maghrébin et anti‑jeunes de banlieue : elle est une religiophobie. Certes, elle peut se combiner avec des formes de xénophobie plus traditionnelles, mais elle se déploie de manière autonome »36.
Pour connoter la détestation, le français a emprunté au grec un autre préfixe: miso-, du verbe miséō (μισέω) « haïr / ne pas accepter », et ce préfixe est compris comme le contraire de philo– (φιλο-)37. D’où « misanthrope », qui déteste les hommes, « misogyne » qui déteste les femmes, « misonéisme », qui déteste la nouveauté, et « misologie » signifiant le refus de raisonner. Utiliser ce préfixe miso- pour fabriquer un mot désignant la détestation des musulmans aurait conduit à quelque chose comme *misomusulmanisme (!), et l’employer avec islam était encore plus difficile. À la fin des années 1990, Basheer Ahmad Frémaux-Soormally avait certes proposé aux responsables de la revue parisienne La Medina le néologisme « misislamisme » pour « décrire le racisme anti-arabe et anti-musulman », mais il n’a pas été suivi38. Actuellement, « misislamisme » est parfois utilisé, par exemple par Ghaleb Bencheikh39, pour désigner la détestation de l’islamisme, et non celle de l’islam ou des musulmans. Au bout du compte, il apparaît que le suffixe -phobie a donc paru préférable pour des raisons strictement linguistiques, liées à l’usage40, et qui ne résultent aucunement d’on ne sait quelle volonté de médicaliser une pensée déviante!
Le xénos (ξένoς) comme le phílos (φίλος) sont en rapport avec les coutumes d’hospitalité, puisqu’en grec ancien xénos (ξένoς) « peut se dire de celui qui est reçu et de celui qui reçoit », et que « l’hôte qui reçoit est le φίλος de l’étranger accueilli, et réciproquement »41. Le xénos, c’est l’étranger avec lequel on est en contact, par opposition avec celui appelé échthrós (ἐχθρὀς) « homme du dehors étranger à toute relation sociale »42, et c’est aussi l’hospité, c’est-à-dire celui qui bénéficie des lois de l’hospitalité43. Ce pourquoi d’un point de vue grec, la xénophobie telle que nous l’entendons était difficilement concevable. Certes, le synonyme misoxène existe bien, mais il est tardif, utilisé par les auteurs chrétiens pour désigner l’attitude des Égyptiens à l’égard des Hébreux. Quant à xénochtone, s’opposant à autochtone, il apparaît sous la plume de Denis d’Halicarnasse (Antiquités romaines, I, 41.1) pour désigner des bandes vivant sauvagement, jusqu’à tuer des étrangers au mépris des règles d’accueil.
L’enquête conduite par Pierre Villard sur l’origine du mot xénophobe lui a permis de vérifier qu’il ne s’agit pas d’un vocable issu du grec ancien, contrairement à ce qu’on pourrait croire. C’est un néologisme forgé par Anatole France pour faire pièce à la notion de métèque — qui, elle, est authentiquement grecque (μέτοικος, au sens propre « qui change de maison », donc: « étranger domicilié dans la cité »), francisée au milieu du xviiie siècle et adoptée par Charles Maurras en 1894 dans La Cocarde, le journal de Maurice Barrès, avec une connotation hostile et très dépréciative44. Pour autant qu’on sache, « xénophobe » a été inventé pour être utilisé dans Monsieur Bergeret à Paris, paru en 1901, roman dans lequel l’auteur, parodiant Rabelais, se moque des « démagogues » qui côtoient les « misoxènes, xénophobes, xénoctones et xénophages »45.
L’islamophobie est une xénophobie, car « l’enjeu central est bien la légitimité de la présence musulmane sur le territoire national, tout comme pour l’antisémitisme des xixe et xxe siècles »46. Elle se base sur un ensemble de préjugés et de stéréotypes stigmatisants, sur des généralisations négatives, sur une catégorisation et une essentialisation des musulmans, ou du moins vus comme tels, arbitrairement réduits à leur religion et à ses « signes », jusqu’à l’élaboration d’une véritable « racialisation religieuse »47. Certes, les modalités de l’islamophobie varient « en fonction des contextes nationaux et des périodes historiques »48, mais le procédé qui la fonde consiste toujours à inventer un « problème musulman » ou un « problème de l’islam »49, puis à lui chercher des solutions passant notamment par le contrôle du corps, de l’habillement, de l’alimentation et de la présence dans l’espace public, voire par le bannissement et l’expulsion.
C’est bien la démarche usuelle de toutes les altérophobies: fabriquer un « autre » pour le rejeter.
Faisons donc nôtre la sentence de Ménandre:
Ξένους ξένιζε ‧ καὶ σύ γὰρ ξένος γ’ ἔσῃ
« Fais bon accueil aux étrangers, car toi aussi, tu seras étranger. »
Bibliographie et sources
Allen Christoph 2010. Islamophobia. Farnham, Burlington: Ashgate, 219 p.
Anawati Georges Chahati 1976. «Dialogue with Gustave E. von Grynebaum.» International Journal of Middle East Studies 7(1): 124.
Asal Houda 2014. «Islamophobie: la fabrique d’un nouveau concept. État des lieux de la recherche.» Sociologie 1(5): 13-29.
Beaugé Julien, & Abdellali Hajjat 2014. «Élites françaises et construction du ‟problème musulman”. Le cas du Haut Conseil à l’intégration (1989-2012).» Sociologie 5(1): 31-59.
Benveniste Émile 1969. Le vocabulaire des institutions indo-européennes. 1. Économie, parenté, société. Paris: Éditions de Minuit, 279 p.
Bravo López Fernando 2011. «Towards a definition of Islamophobia: approximations of the early twentieth century.» Ethnic and Racial Studies 34(4): 556-573.
Bravo López Fernando 2012. En casa ajena: bases intelectuales del antisemitismo y la islamofobia. Barcelona: Bellaterra, 368 p.
Bruckner Pascal 2010. «L’invention de l’”islamophobie”.» Libératiion 23 novembre: http://www.liberation.fr/societe/2010/11/23/l-invention-de-l-islamophobie_695512/.
Chantraine Pierre 1968. Dictionnaire étymologique de la langue grecque. Histoire des mots. Paris: Klincksieck, 4 t. en 5 vol., 1368 p.
Cook Stanley A. 1924. «Chronicle. The history of religions.» Journal of Theological Studies 25(97): 101-109.
France Anatole 1901. Monsieur Bergeret à Paris. Paris: Calman Lévy, 404 p.
Geisser Vincent 2003. La Nouvelle Islamophobie. Paris: La Découverte (Sur le Vif), p.
Geisser Vincent 2010. «Islamophobia: a French Specificity in Europe?» Human Architecture: Journal of the Sociology of SelfKnowledge 8(2): 39-46.
Hajjat Abdellahi, & Marwan Mohammed 2016. Islamophobie: comment les élites françaises fabriquent ‟le problème musulman”. Paris: La Découverte, 328 p.
Halevi Ilan 2015. Islamophobie et judéophobie. L’effet miroir. Paris: Syllepse, 180 p.
Ibrahim Raymond 2009. «Are Judaism and Christianity as Violent as Islam?» Middle East Quarterly 16(3): 3-12.
Kepel Gilles, & Bernard Rougier 2016. «‟Radicalisations” et ‟islamophobie”: le roi est nu.» LIbération 14 mars 2016: http://www.liberation.fr/debats/2016/03/14/radicalisations-et-islamophobie-le-roi-est-nu_1439535/.
Knobel Marc 1999. «George Montandon et l’ethno-racisme.» In: Pierre-André Taguieff, & Grégoire Kaufmann, L’Antisémitisme de plume, 1940-1944. Études et documents, Paris: Berg International, p. 277-293.
Lebourg Nicolas 2011. «La diffusion des péjorations communautaires après 1945.» Revue d’éthique et de théologie morale 4(267): 35-58.
Lorente Javier Rosón 2010. «Discrepancies Around the Use of the Term “Islamophobia”.» Human Architecture: Journal of the Sociology of Self-Knowledge 8(2): 115-128.
Onfray Michel 2016. Penser l’islam. Paris: Grasset, 180 p.
Pinsker Leo Semenovi 1882. Autoemancipation! Mahnruf an seine Stammesgenossen. Von einem russischen Juden. Berlin: Issleib in Comm, 36 p.
Quellien Alain 1910. La politique musulmane dans l’Afrique occidentale française. Paris: Émile Larose, vii-278 p.
Sibony Daniel 2004. «Ne pas aimer n’est pas phobie.» Libération 9 décembre: http://www.liberation.fr/tribune/2004/12/09/ne-pas-aimer-n-est-pas-phobie_502317/.
Sibony Daniel 2013. Islam, phobie, culpabilité. Paris: Odile Jacob, 224 p.
Vakil AbdoolKarim 2003. «Is the Islam in Islamophobia the Same as the Islam in Anti-Islam; or, When Is It Islamophobia Time?» e-Cadernos CES 3: http://eces.revues.org/178; DOI : 10.4000/eces.178.
Villard Pierre 1984. «Naissance d’un mot grec en 1900. Anatole France et les xénophobes.» Mots 8(1): 191-195.
Zapata-Barrero Ricard 2006. «The Muslim community and Spanish tradition: Maurophobia as a fact and impartiality as a desideratum.» In: Tariq Modood, Anna Triandafyllidou, & Ricard Zapata-Barrer, Multiculturalism, Muslims and Citizenship: a European approach, London: Routledge, p. 143-161.
Notes
1 Selon le CNTRL (Centre National de Ressources Textuelles et Lexicales), s.v.
2 http://www.prochoix.org/cgi/blog/index.php/2003/11/12/55-islamophobie/
3 Bruckner 2010.
4 Knobel 1999.
6 Alban Ketelbuters, « Laïcité: lettre à Najat Vallaud-Belkacem », Marianne, tribune du 10 novembre 2014.
7 http://www.laicite-republique.org/prix-de-la-laicite-2015-discours-de-patrick-kessel.html/
9 http://www.marianne.net/regis-debray-chantage-islamophobie-est-insupportable-100239746.html/
10 Le Monde des Idées, 7 mai 2016: 4.
11 Kepel & Rougier 2016.
12 Allen 2010.
13 Bravo López 2011.
14 Pour un état des lieux en français des recherches sur l’islamophobie, voir Asal 2014.
15 Onfray 2016: 56.
16 Quellien 1910: 133.
17 Quellien 1910: 133-134.
18 Cook 1924, apud Hajjat & Mohammed 2016; voir aussi Asal 2014: 15.
19 Bravo López 2011: 562.
20 « What makes the task difficult, perhaps impossible, for a non-Muslim is that he is compelled, under penalty of being accused of Islamophobia, to admire the Koran in its totality and to guard against implying the smallest criticism of the text’s literary value » (Anawati 1976).
21 Voir à ce propos Vakil 2003.
22 Exemple de ce raisonnement sur un site d’extrême droite: http://www.bvoltaire.fr/jacquesflinois/france-lislamophobie-desormais-haram-illicite,233137/
23 Lebourg 2011: 42.
24 Sibony 2013.
25 Asal 2014: 17.
26 Sibony 2004.
27 CNRTL: s.v.
28 Sur l’internet, on trouve ainsi « hispanophobe », « italophobe », « nippophobie », etc.
29 Zapata-Barrero 2006.
30 Lorente 2010: 123-124.
31 Geisser 2010: 43.
32 Pinsker 1882.
33 Halevi 2015.
34 Bravo López 2012.
35 Pour les salafistes, voir par exemple http://www.salafidemontreal.com/index.php/articles-ouvrages-traductions-et-fatawa/divers-sujets-refutations/20-voici-des-versets-de-la-bible-que-les-chretiens-et-les-juifs-ont-oublies.html/ Pour Michel Onfray, voir Onfray 2016, passim. D’autres se sont livrés au vain exercice de savoir quelle religion est la plus violente, de l’islam ou du judaïsme/christianisme (voir par exemple Ibrahim 2009).
36 Geisser 2003: 10-11.
37 Chantraine 1968: 705.
38 http://www.alterinfo.net/ISLAMOPHOBIE-LA-HAINE-LA-PLUS-ANCIENNE_a20133.html.
40 Par exemple, en cas de néologie, un mot bref est préférable.
41 Chantraine 1968: 764, 1204.
42 Chantraine 1968: 391.
43 Benveniste 1969: 360-361.
44 Villard 1984. Dans le numéro de La Cocarde du 7 mars 1895, Maurras évoquera « le mépris que nous inspirait à Paris le métèque arrogant et vil ».
45 France 1901: 101.
46 Hajjat & Mohammed 2016.
47 Asal 2014: 19.
48 Hajjat & Mohammed 2016: introduction.
49 Sur le rôle du Haut Conseil à l’Intégration dans le processus ayant conduit à cette invention, voir Beaugé & Hajjat 201
Le G.U.D. est un paradoxe historique : devenu symbole de l’inorganisation nationaliste et de l’activisme d’extrême droite, il a été originellement créé pour conduire les ex-meneurs d’Occident au réel travail politique. En effet, l’après-dissolution de leur mouvement (1968) les voit vouloir créer un syndicat universitaire (ce que n’était nullement Occident), l’Union-Droit, qui reçoit des gauchistes l’appellation de G.U.D. ; le sigle est repris et les militants eux-mêmes se qualifient de « gudards ». Le « D » du sigle signifie rapidement « Défense » en lieu et place de « Droit », passant bien de l’objet syndical à l’idée d’une communauté (l’Union) activiste. Le G.U.D. a pour particularité d’être sans doute le seul syndicat étudiant dont les membres sont très souvent non-étudiants ; ici « étudiant » doit s’entendre « jeunes ». Il est à l’origine de la fondation d’Ordre Nouveau (1970). Il en est ensuite la branche étudiante, puis, après la dissolution d’O.N. par l’Etat (1973), celle de sa reconstitution, le Parti des Forces Nouvelles. A partir de 1981, auto-dissout officiellement, il passe du statut de syndicat à celui de « mouvement » au sens le plus éthéré du terme (i.e. qu’il y a en fait des G.U.D. : est G.U.D. qui dépose la « marque » et a les moyens de faire respecter son usage). En 1985, il participe à la fondation de Troisième Voie, avec qui il rompt en 1988. D’un néo-fascisme a-dogmatique il a évolué vers des positions nationalistes-révolutionnaires : antiaméricanisme, adoption de l’utopie d’une Europe fédérée des régions mono-ethniques, et assimilation de son combat à celui du peuple palestinien autour du slogan « A Paris comme à Gaza Intifada ! » (1995). Désormais le rat noir porte le keffieh des feddayin… pour se rapprocher du Front National puis participer à Unité Radicale (1998), dont il fit scission, début 2002, au motif de la pureté idéologique et de son envie… Par-delà, le G.U.D. est avant tout une légende d’auto-représentation : celle du rat noir persifleur, manieur de barre de fer, oscillant entre chaos et répression réactionnaire.
Les années 1970 : au début était l’action…
Dès ses débuts, le G.U.D. suit l’exemple d’Occident. Il multiplie les bagarres, de plus en plus violentes, ce qui produit des réactions journalistiques, et permet effectivement de rallier toujours plus de nouvelles recrues. Il faut noter qu’en cette période où tous les groupuscules rêvent que les événements de Mai leur permettent de constituer un réel parti, le G.U.D. n’est pas le seul à user de cette technique : les maoïstes de la Gauche Prolétarienne suivent la même tactique avec pour résultat le même afflux militant1. Le fait que les deux extrêmes misent sur l’activisme simplifie d’ailleurs grandement la tâche de leurs états-majors respectifs, puisque chacun est disposé à l’affrontement. Lorsque Ordre Nouveau est en place, il s’installe d’abord dans le XVe arrondissement parisien pour une raison simple : et le G.U.D. et la Ligue Communiste y sont implantés, d’où bagarres, d’où retombées médiatiques. C’est toutefois surtout sur le territoire des universités que le groupe se fait remarquer : combat du G.U.D. et d’étudiants de droite contre les gauchistes à Assas en février 1970 (2 jours de fermeture) ; affrontements extrêmement violents du G.U.D. et des maoïstes et lambertistes à Nanterre en mars ; le même mois, attaque par le G.U.D. d’un meeting commun gauchiste antifasciste à Assas : 23 blessés graves chez les gauchistes, etc.
Le style « barres de fer, croix celtique et humour provocateur » devient un élément central de l’auto-représentation du G.U.D., symbolisé par un emblème né fin 1970 et rapidement devenu légende, le rat noir belliqueux. Celui-ci est mis en scène en bande dessinée par Jack Marchal, cadre d’Ordre Nouveau, presque tous les jours sur le panneau du syndicat à l’Université dite d’Assas, avec un talent indéniable et un humour ravageur qui ne sera jamais égalé par ses successeurs. Non seulement il devient indissociable de la jeunesse nationaliste, mais son succès est rapidement européen, les autres syndicats étudiants nationalistes du continent s’en emparant à leur tour.
Le choix même du medium représente une ouverture à la modernité, et en ce sens peut expliquer que les successeurs de Jack Marchal n’aient jamais retrouvé sa qualité. En effet, la facture de ce dernier est marquée par une influence de l’underground américain (il est impossible de ne pas songer à Crumb), ce qui est des plus significatifs, tandis que ses émules réalisent de la bande dessinée estudiantine, totalement détachée des évolutions et contextes de ce moyen d’expression. Les planches de Jack Marchal allient le sens du rythme, de l’image-choc, de l’auto-dérision et de la propagande. Dans un entretien, le dessinateur est longuement revenu sur cette genèse du rat. Il explique qu’alors qu’il le dessinait « Gérard Ecorcheville, le camarade qui à ce moment-là gérait la propagande du G.U.D., eut une illumination dont on ne pourra jamais assez le remercier : « Hé, ce rat… Mais c’est nous ! ». Cette remarque géniale a levé une des principales difficultés qui se posait à moi, et qui était de savoir comment représenter le G.U.D. dans les événements où il était acteur. Sous l’aspect d’héroïques chevaliers hyperboréens ? de jeunes filles et jeunes gens propres sur eux ? en brutes casquées toujours victorieuses ?… Bref, en un tournemain, nous avons trouvé à la fois une auto-représentation satisfaisante, un logo, un signe de ralliement qui faisait clairement la différence entre nous et tous les autres, un symbole, tout un style qui allait avec… [A Occident,] Duprat ne cessait de traiter tout le monde et n’importe qui de « Rat visqueux ! Rat pesteux ! Rat scrofuleux ! » (…). Pas mal de responsables et militants ont reçu un sobriquet dans cette veine. L’un, qui habitait un petit local semi-souterrain auquel on accédait par l’entrée des caves, était surnommé Rat d’Égout… Tel autre, de petite taille, était appelé Musaraigne. Quant au plus entreprenant des responsables action, on ne le connaissait que sous le nom d’Anthracite ». C’est ainsi Alain Robert, meneur d’Occident, qui reçoit pour sobriquet ce nom du rat ennemi de Chlorophylle dans la bande dessinée animalière de Raymond Macherot… Enfin, il semble que les nationalistes puissent lire dans les affrontements entre Anthracite et Chlorophylle un sous-texte politique que nul n’avait perçu, mais qui témoigne de manière extrêmement intéressante de la façon dont une vue du monde ingurgite et recycle tous les signes (avec la forte possibilité qu’il y ait aussi une certaine dose d’autodérision) : « Anthracite ne respecte aucun tabou, il lève les interdits, il est le grand catalyseur dionysiaque, l’anarque absolu, le libérateur des puissances du désir (…). Les gardiens de l’ordre établi sont systématiquement présentés comme des abrutis. Ils ne font pas le poids quand se révèlent soudain volonté de puissance et agressivité dans un monde qui croit les avoir refoulées. Seul Chlorophylle, devenu petit bourgeois conservateur, sait encore être efficace car son hostilité à Anthracite vient de plus loin, elle plonge ses racines dans la nature sauvage. Ne serait-ce l’inévitable deus ex machina qui le fait échouer à chaque épisode, Anthracite serait évidemment vainqueur. Sans garantie de durée toutefois : dès le premier album, son autoritarisme avait provoqué chez les rats noirs une guerre civile dévastatrice entre les monarchistes fidèles à sa personne et les insurgés. Il y a chez Macherot une morale des rapports sociaux qui s’élève jusqu’à une conception cyclique du devenir des sociétés politiques »2.
La propagande n’est pas le seul moyen de se doter d’un bastion. Dès 1970, le G.U.D. a entamé une politique de chasse absolue aux militants de gauche afin de rendre Assas vierge de leur présence et d’offrir aux rats noirs leur « Nanterre ». Cette méthode d’implantation locale était très goûtée des néo-fascistes italiens et est ainsi importée. Les militants parviennent à associer l’image de l’Université à la leur, et le jeu de mots « Waffen Assas » devient bientôt un classique de l’humour nationaliste (ainsi que celui de « Groupuscule des Dieux »). Néanmoins, l’opération « zéro gauchiste » sur les campus n’a jamais pu être rééditée. Nulle part ailleurs, l’extrême droite ne dispose en effet d’assez d’étudiants activistes pour être à l’aise, voire bien souvent pour tout simplement oser s’afficher (l’Union Nationale Inter-universitaire offrant toutefois généreusement l’asile en ayant le mérite d’être moins compromettante socialement pour la suite, voire de permettre une reconversion vers une vraie carrière politique)3.
Assas provoque toutefois des convoitises, le G.U.D. y subit les attaques politiques et physiques des Groupes Action Jeunesse. Pour garder son espace, le le G.U.D. entame une répression de ses amis politiques à coups de barre de fer. Ces derniers répondent par une bataille aux cocktails molotov. Les gudards sont ainsi éclectiques dans leur combat. Ils ont certes fait le service d’ordre du candidat Valéry Giscard d’Estaing en 1974 et en 1981 mais ils peuvent s’entendre avec des maoïstes pour matraquer les meneurs d’une grève estudiantine4. Les gudards se cotisèrent même pour le bénéfice du service d’ordre trotslyste lambertiste après que celui-ci ait infligé une raclée à ceux du Parti Communiste Français et de la Ligue Communiste Révolutionnaire5. Mais les années 1970 se meurent en même temps que le gauchisme estudiantin s’effondre, privant le G.U.D. de son ennemi, de sa raison d’être. La décrépitude est marquée par une Bérézina activiste. En 1980, le G.U.D. et les étudiants du Mouvement Nationaliste-Révolutionnaire dirigé par Jean-Gilles Malliarakis (lui même ancien dOccident et compagnon de route d’Ordre Nouveau) décident d’ensemble « reprendre » l’université de Paris X-Nanterre : la cinquantaine de militants qui s’y rend fait 23 blessés avant de ravager la rame de métro. 27 nationalistes sont arrêtés. Le G.U.D. s’affirme victime innocente, argue que ses militant seraient venus désarmés et auraient été victimes des enragés gauchistes. Le M.N.R. soutient totalement, et avec emphase, les gudards et leur version des faits6. Avec ses militants poursuivis par la justice pour ces faits de violence et face à la victoire de la gauche, le G.U.D. s’auto-dissout. Affirmant qu’il faut réaliser une nouvelle alliance des extrêmes droites qui dépasse le cadre estudiantin, l’ex-G.U.D. tend dès cet instant la main au Front National de la Jeunesse et au M.N.R.7
Les années 1980 : le Rat noir se cherche une meute
Le G.U.D. continue donc sa vie en underground. Après les services d’ordre de la campagne électorale de 1981, il est de nouveau en fonds et s’insère dans le Renouveau Nationaliste mis en place par le Parti des Forces Nouvelles en 1982. La nouvelle formation se présente comme la formation unitaire de la jeunesse nationaliste (ce que refusent tous les autres groupes) et place toute sa propagande graphique dans la continuité d’O.N. et d’Occident. Le G.U.D. reprend un coup de fouet avec le mouvement scolaire de 1983-84 ; dès le printemps 1984, les sections G.U.D. et M.N.R. de Strasbourg, Orléans, Lyon et Perpignan travaillent ensemble, à la base8. Charles-Henri Varaut, jeune leader du G.U.D. de 23 ans, meurt à la fin de l’été 1984. L’hommage que lui rend Bertrand Burgalat dans la presse du M.N.R. témoigne des rapports entre les deux groupes mais aussi, à travers l’émotion du texte, de la constitution d’un champ de référents culturels communs : « Il aurait voulu quitter la terre face au soleil, mais une société qui conjure le risque ne connaît que des morts stupides. Charles-Henri Varaut s’est tué à vingt-trois ans sur une route de Provence. La jeunesse nationaliste perd un camarade, pour beaucoup un ami fidèle et attachant. Au revoir Charles-Henri. Nous n’avons pas de passé, mais nous avons une immense mémoire. Nous aurions aimé traverser le Rubicon avec toi et chaque fois que nous franchirons le hall d’Assas, nous prierons les Dieux pour que tu ne trouves pas de vigiles dans l’éternité, mais les hauts tambours qui rythmaient ton cœur. »9 Au fil des lignes, les références s’enchevêtrent et elles sont avant tout musicales : J’avais un camarade, le Cara al sol phalangiste ; les tambours sont ceux des Lansquenets. Certes, l’auteur du texte est un artiste, mais il y a là une cohérence certaine qui est plus du domaine d’une culture souterraine partagée et populaire (chants, humour) que du système politique. Cela est tout à fait révélateur de la façon très sentimentale, antidogmatique, d’être fasciste en une ère postmoderne et matérialiste. N’importe le manque absolu de prise sur le réel social : ce qui compte c’est de fonder une communauté qui se définit par le partage d’une contre-culture.
N’en demeure pas moins qu’il faudrait sauver les formes et que sans ennemi gauchiste, les gudards s’ennuient. Les affrontements avec des bandes de jeunes Noirs peuvent certes les occuper, signe du remplacement d’un ennemi politique par un ennemi racial, signe aussi du désœuvrement et de la réclusion à la marge10.Ainsi l’activisme, dépourvu de sens dans la France de ces années, devient bien plus un écran de fumée que les nationalistes projettent pour s’inventer un monde qu’un mode opératoire ayant une quelconque logique politique. Le G.U.D. n’est plus que l’ombre de lui-même : dans son bastion historique d’Assas il n’obtient aux élections universitaires que 93 voix sur plus de quatre mille suffrages11. Le M.N.R. était alors lui aussi en mauvaise posture et il s’ouvre aux quatre vents. Les activistes légitimistes de la Garde Blanche le rejoignent, menant avec eux certains de leurs amis, y compris du G.U.D. Entre ces adeptes du coup de poing et la volonté politique de l’équipe du M.N.R, le courant ne passe pas complètement. La constitution de la Jeune Garde va permettre d’éviter le clash12.
Le processus d’unification débute officiellement pendant l’été 1984, après les élections européennes où le F.N. a obtenu 11% des votes et repoussé par là-même tous les autres mouvements d’extrême droite hors du monde politico-médiatique. Ce sont les jeunes P.F.N. qui, avec ceux du M.N.R., engendrent un nouveau mouvement, la Jeune Garde, qui reprend ainsi le nom du nouvel hymne du M.N.R. et par-delà dessine une généalogie avec les G.A.J. et leur Jeune Garde solidariste. La J.G. n’a pas pour fonds baptismaux quelque opération révolutionnaire, mais les manifestations de juin pour les entreprises d’enseignement privé catholique (« l’école libre ») : « il ne s’agit plus d’attaquer l’Aéroflot, encore moins de prendre la Bastille : il s’agit d’affirmer l’Idée Nationaliste à l’avant-garde de l’opposition populaire » écrit Jeune Nation solidariste. C’est sur ce droitier principe qu’est décrété, le 3 juillet, sur la base du programme du M.N.R., que le G.U.D., et les jeunes M.N.R. fusionnent pour donner jour à la J.G.13 C’est donc à ce stade, manifestement, une première entente PF.N.-M.N.R. via le G.U.D. et au bénéfice du M.N.R. Toutefois, cette annonce de fondation est assez étrange, car la première section de la J.G. n’est fondée que le 21 février 1985, à Perpignan, avec un président portant le même nom de famille que celui de son correspondant de la section PF.N. locale… Il semble, en fait, qu’au printemps 1985 des sections unitaires M.N.R.-PF.N. sont réalisées à Perpignan, Bordeaux et Toulouse, et on annonce dès cet instant la création d’un parti unitaire pour l’automne14. Le Secrétariat National de la J.G. est lui-même fondé en février 198515.
Ces rapprochements et naissances permettent aux néo-fascistes d’annoncer la naissance d’une union des nationalistes, baptisée Troisième Voie, tenue par l’équipe de feu le M.N.R. Leur espoir est de récupérer les déçus du lepénisme qu’ils récupèreraient sur la base d’un discours révolutionnaire et populaire. La réunion de fondation rassemble une centaine de personnes. Le nouveau mouvement ne se défait pas du style « humour gudard » en naissant : on déclare au journaliste présent qu’étant donné le succès « la prochaine fois il faudra qu’on prenne un stade »16.
Troisième Voie ne souhaite pas laisser les jeunes trop s’ébrouer. La J.G. et du G.U.D. reçoivent une attention toute spécifique : ce sont « des appellations strictement contrôlées par le Mouvement » dont les actions s’exercent sous le contrôle de la direction, mais qui « sont des sigles autonomes autorisés à enregistrer des adhésions sympathisantes (sic), placées sous la responsabilité de la structure régionale »17. C’est-à-dire que, face au caractère foncièrement provocateur des jeunes, est mis en place un système qui permet de les canaliser et de s’en désolidariser. L’agitation gudarde n’est pas mauvaise en soi, loin s’en faut. C’est encore le G.U.D. qui crée l’événement au cortège Jeanne d’Arc de 1986 avec une banderole frappée de la croix celtique qui apostrophe le nouveau ministre de l’Industrie en ces termes : « Madelin paye ta cotise » – sa photographie a un large écho dans la presse et c’est un prétexte somme toute bien pensé pour faire parler du G.U.D. et de T.V.
Les groupes ont vu leurs compétences être redistribuées, la J.G. étant en charge des lycéens et le G.U.D. des étudiants, les mouvements cosignant également les tracts en tant que jeunes de T.V. En un an, le G.U.D.-JG a organisé un camp d’été regroupant 50 personnes et il voit ses effectifs s’élever à 120 cartes, ayant ainsi 30 encartés et 50 sympathisants à Paris comme à Aix-en-Provence, ou 10 encartés à Nantes. Certains membres se rebiffent localement, la section toulousaine passe ainsi de 18 à 4 adhérents. Il faut, certes, leur rappeler quelques principes de l’action partisane, par exemple que « La Jeune Garde est un mouvement politique et non une bande de copains », ou que « Nous ne sommes pas un repère de mythos ratonneurs », mais certains s’avèrent très dynamiques. La section de Perpignan, avec ses 8 encartés et 14 sympathisants, est ainsi montrée en exemple pour être parvenue à faire publier plusieurs articles dans la presse locale et à disposer de deux élus dans l’université de leur ville18. Son responsable est préposé, aux assises fondatrices de la J.G., au rapport sur les conditions d’implantation locale19. Néanmoins, le G.U.D. adopte derechef et massivement ses mœurs coutumières. L’action syndicale n’est jamais facile pour les gudards, qui attaquent à la grenade à plâtre le local de l’U.N.E.F., entraînant contre eux une motion du conseil de l’université de Perpignan réclamant des poursuites judiciaires. Le travail syndical est ainsi ruiné par la facilité de l’activisme : Perpignan n’était pas Assas et le G.U.D. l’ignorait… Au niveau national, le G.U.D. en revient au matraquage frénétique des étudiants manifestants (hiver 1986, mouvement contre la Loi Devaquet) qui braque sur lui les feux de la rampe médiatique et du microcosme extrême droitier, lequel retrouve là ses image et rôle de champion de la réaction. L’apport militant engendré tend à repositionner le G.U.D. vers son penchant initial d’ultra-droite anticommuniste activiste se donnant des airs révolutionnaires (phénomène déjà dénoncé par Duprat) et, de plus en plus, il ne resurgit que pour produire des agressions sur les campus contre les étudiants de gauche20.
Le travail avec la jeunesse estudiantine n’est donc pas aisé et, au premier janvier 1987, T.V. décide de centraliser les adhésions en adoptant un système de carte unique, privant le G.U.D. et la J.G. de leur autonomie. Il n’est pas totalement fortuit que cette résolution soit concomitante de la décision d’une accélération des cours de formation par la préparation de séminaires de fin de semaine en gîte rural21. L’année suivante, le Conseil National du mouvement précise que le seul nom à déclarer en préfecture est celui de T.V.22, G.U.D. et J.G. deviennent donc de facto des noms qui n’existent plus que dans le matériel de propagande. Face aux débordements des cortèges Jeanne d’Arc, devenus à l’évidence essentiels à cause de l’éclosion du F.N., la direction diffuse de claires et impératives recommandations : ni provocation, ni violence, ni injure ne sont admis de la part des militants. On informe les militants que, désormais, les croix celtiques sont interdites dans les manifestations. Lorsque est organisée une commémoration en l’honneur de Brasillach, il est précisé que ce sont les « paroles françaises » de J’avais un camarade qui doivent être entonnées. On souligne que, si le fascisme est considéré comme positif, cela doit rester confidentiel et que tout folklore mussolinien est interdit en public23.
En somme, les gudards et les tercéristes prennent de la distance, et les seconds tentent d’y remédier en resserrant des liens de sujétion établis à leur profit. Les premiers n’ont pas l’assise doctrinale de l’équipe de Jean-Gilles Malliarakis, ils n’apprécient ni la critique permanente du F.N., les rapprochements étant sanctionnés par la direction de T.V. par une exclusion pour « contacts avec la réaction », ni que l’activisme soit bridé, les comportements typiquement gudards pouvant entraîner l’exclusion pour « provocation ».
Certes, le G.U.D. s’est « Nrisé » avec T.V., mais c’est justement sur un thème NR, adopté par capillarité auprès de T.V., « Nous ne serons pas les Palestiniens de l’Europe », qu’il organise un meeting propre où il constate son succès et, partant, la possibilité de revoler de ses propres ailes. Il se procure de nouveau un peu d’argent en assurant, durant la campagne des élections présidentielles de 1988, le service d’ordre de Raymond Barre. A T.V., certains n’apprécient pas forcément ce travail pour celui que Jean-Gilles Malliarakis désigne depuis dix ans comme un agent de la Trilatérale (ou, tout du moins, ils affirment après coup ne pas l’avoir apprécié). Le 7 mai 1988, le G.U.D. peut donc organiser un nouveau meeting à Paris, « Préparons l’alternative nationaliste », où il annonce sa rupture avec T.V. et la reprise de son indépendance. Les mauvaises relations sont encore tendues par l’inimitié entre William Bonnefoy, qui a pris la direction des gudards, et Jean-Gilles Malliarakis. Leur dégradation continuelle aboutit à ce que le G.U.D. attaque un meeting organisé par T.V. le 26 mai 1989, à la Mutualité. Il y découvre, effaré, qu’il est une chose d’attaquer des étudiants sur un campus, une autre d’attaquer d’autres nationalistes : c’est au fusil qu’on lui répond24.
En définitive, T.V. a certes fait évolué politiquement mais aussi sociologiquement le G.U.D. Jusque là il était depuis toujours composé d’enfants de la bourgeoisie. Ils ont découvert des prolétaires de droite et Vaincre, le bulletin gudard, est sans doute le premier dans la presse d’extrême droite à avoir traité de la musique skinhead. La décennie suivante étant particulièrement marquée par la prolétarisation de la composition sociologique de ce champ politique, c’est là un élément des plus notables.
Les années 1990 : le Rat noir voyage
Comme toutes les marges politiques en voie de disparition, le G.U.D. trouve de l’oxygène dans le légendaire des luttes étrangères. Avec les dissidents frontistes d’Espace Nouveau il créé ensemble un Comité France-Croatie puis un Front Franco-serbe de Solidarité25. Des membres du G.U.D. rejoignent les combattants croates, recyclant les anciens slogans : « aujourd’hui Osijek, demain Paris ! ». Présents durant un semestre, ils reviennent ensuite en France et il n’est sans doute pas fortuit que ce retour coïncide avec celui de l’activisme anti-gauchiste : après avoir combattu les « communistes » serbes, le G.U.D. ne saurait plier devant ceux des facultés26. L’engagement armé en Croatie devient l’objet d’une lutte symbolique de légitimation27. Ainsi, quand bien même il s’agirait de faire preuve d’ouverture en s’entendant avec des nationalistes étrangers, l’esprit de division prime, au-delà du courage physique des uns et des autres, en ce qui concerne les implications intérieures de cet engagement. Ce dernier n’est pas motivé par une analyse documentée et circonstanciée, mais par des considérations esthétiques et sentimentales. Cette impulsion rencontre un intérêt tout ce qu’il y a de plus intérieur : faire concurrence aux autres nationalistes de par la production d’un légendaire combattant, d’un héroïsme romantique et empirique.
L’indépendance du G.U.D. n’était qu’une chimère. Le « label » G.U.D. n’a pu perdurer qu’en passant une fois de plus sous les fourches caudines. La question est résumée par son nouveau chef, Frédéric Châtillon, en 1992 : « On aide le Front parce que sinon on ne serait qu’une poignée ». En 1990, sous l’égide de l’ancien sympathisant de T.V. Michel Murat, est lancée par le F.N. une confédération syndicale des étudiants nationalistes, le Renouveau Etudiant, au sein duquel le G.U.D. collabore avec divers groupes rassemblés autour du F.N.J. Il co-fonde avec celui-ci un Rassemblement Etudiant Parisien à l’objectif ainsi résumé par l’ex-G.N.R., devenu très proche de Bruno Mégret dans la direction du F.N., Franck Timmermans : « Au-delà des querelles passées, l’union est faite et nous allons leur en mettre plein la gueule ». C’est au sein du G.U.D. un ex-T.V. qui a poussé à cette stratégie, au sein du F.N.J un ancien du G.U.D. et Damien Bariller, membre du G.R.E.C.E. et directeur de cabinet de Bruno Mégret. Le meeting a lieu sans lepénisme aucun, mais avec un hommage appuyé à Pierre Vial, le leader de l’aile völkisch, et des références à Drieu, Brasillach ou Degrelle. Eric Rossi, skinhead et politologue, rapporte à propos de cette manifestation qu’« au cours d’une réunion rappelant étrangement les meetings du mouvement Troisième Voie, Michel Murat exhortera une salle bondée à se battre pour conquérir « le pouvoir pour mille ans »… »28. Samuel Maréchal, ex-T.V., gendre de Jean-Marie Le Pen et responsable du F.N.J., tente de s’appuyer sur le G.U.D. pour contrer les amis de Bruno Mégret au sein du R.E. et du F.N.J. Le G.U.D. obtient de pouvoir participer à la fête des Bleu-Blanc-Rouge et enchaîne… en rejoignant les mégretistes ; il forme leur service d’ordre (1997) afin de protéger cette aile du service d’ordre du parti, le Département Protection Sécurité29. Les gudards participent ainsi à tous les conflits internes à l’extrême droite sans hésiter à changer plusieurs fois de camp. Ainsi eux qui avaient rossé plusieurs membres de Nouvelle Résistance, dont l’un de ses dirigeants, en considérant qu’ainsi ils « cassent du gauchiste » rejoignent les débris de Nouvelle Résistance pour former Unité Radicale…30
En effet, le G.U.D. est le seul groupe à répondre positivement à l’appel unitaire donnant naissance à Unité Radicale. Cet accord a surtout une valeur symbolique : le G.U.D. est alors plus que jamais un groupe plus ou moins fantôme, mais dont le nom représente une « légende » (pour les militants nationalistes, pour les media, pour les gauchistes qui, à l’énoncé de ce nom, voient surgir les barres de fer). Par quelques violences, il refait parler de lui dans les media lors du lancement d’U.R., reprenant sa tactique coutumière de provocations publicitaires. Cela redémontre comment, pour le développement d’un mouvement nationaliste, la violence est nécessaire pour amorcer la pompe de sa renommée, d’où la nécessité impérative de toujours prendre le contrôle de l’étiquette G.U.D. U.R. le montre bien, qui expose que la presse relaye presque à coup sûr les violences du groupe, lui assurant une judicieuse publicité31.
Cela pose toutefois des problèmes révélateurs : a) l’organisation se plaint que ses militants se revendiquent du G.U.D. plutôt que d’elle32 ; b) la violence attire les personnes posant des problèmes pour l’action politique structurante : on ne peut considérer comme un simple hasard le fait que Maxime Brunerie décide, parmi les trois affiliations existant officiellement au sein d’U.R., de rejoindre le G.U.D. ; il n’est en rien étudiant, mais bel et bien soucieux de correspondre à une imagerie activiste. Dans le même esprit, le skinzine Jeune Résistance devient un temps l’organe du G.U.D. et il y use d’un slogan typique : « La barre de fer comme moyen d’expression ». Mais toutes les violences dont on s’y flatte ont un point commun : elles frappent des adversaires désarmés. La violence du premier G.U.D. s’exerçait contre des militants aguerris, organisés, pour le moins aussi violents que les néo-fascistes. Désormais il s’agit de personnes qui n’ont aucun rapport avec la violence physique. La violence dont se flatte U.R. est d’un apport nul dans le domaine du combat politique et ne sert qu’à surjouer l’image du « méchant » : universitaire réputé de gauche frappé au visage par le casque de moto qui couvre le visage de l’attaquant ; attaque de l’écrivain libertaire Maurice Rasjfus par « trois courageux jeunes gens » dont la somme des âges ne fait peut-être pas celle de l’agressé ; Noir marchant dans la rue qui se fait poignarder à la sortie du restaurant où se fêtaient les trente ans du G.U.D. (après destruction du lieu et passage à tabac de son propriétaire) ; attaque armée de vendeurs de journaux Ras l’Front sur un marché, barres de fer contre feuilles de papier ; apologie du colleur d’affiches du F.N. dont le courage révolutionnaire a consisté à tirer une balle dans le dos d’un Noir de 14 ans… On ne trouve en revanche aucune trace d’un affrontement avec des activistes redskins ou sionistes.
C’est là le signe d’une profonde déconstruction politique, les jeunes nationalistes croyant s’inscrire dans un légendaire de combat quand leur attitude ne renvoie en miroir qu’à celle des délinquants qu’ils conspuent. Cependant, le redéveloppement militant paraît avoir permis un réépanouissement politique ; alors qu’U.R. vire à droite vers des positions plus identitaristes, völkisch, que NR, le G.U.D., toujours contradictoire, connaît son propre chemin.
Conforme à sa tradition, le G.U.D. décide de lancer un nouvel organe qui lui soit propre, Jusqu’à nouvel ordre (1999), et il refuse de faire preuve du même enthousiasme philo-mégretiste que la direction d’U.R. suite à la partition du F.N. (décembre 1998-janvier 1999) en en un lapidaire slogan : « ni œil de verre ni talonnettes ». Trente ans plus tôt, Jusqu’à Nouvel ordre aurait fait hurler le rat noir à la trahison de l’Occident. « Il n’y a qu’un ennemi de l’Europe, les Etats-Unis, et tous les autres fléaux qui nous touchent – mondialisme, libéralisme, immigration – ne sont que les outils de sa domination » lit-on dans l’éditorial. Le dossier sur « la trahison des nationalistes » s’achève en considérant que « le Dr Goebbels disait au soir de sa vie « Avec les Russes nous perdrons notre liberté, avec les Américains nous perdrons notre âme ». Mais le climat n’était pas favorable aux adages berlinois… (…) L’anti-islamisme n’est qu’un paravent de la soumission au lobby. [Que les membres de l’extrême droite] comprennent que ce qu’est le sort des Palestiniens aujourd’hui sera demain le nôtre si la mainmise sioniste sur l’Europe, à l’extension de laquelle ils contribuent par leur soutien à Israël, se faisait totale. Qu’ils comprennent que la Cisjordanie est le banc d’essai de la mondialisation sous direction américano-sioniste. Voulons-nous être les Palestiniens de l’Europe ? »33. Le G.U.D. conserve néanmoins ses ambiguïtés quant à la réaction. Au premier mai 2000, c’est le F.N. qui lui refuse de défiler avec lui. Un an plus tard, le D.P.S. et le G.U.D. chargent conjointement à Nice les manifestants contre la mondialisation suite aux insultes qu’ils auraient adressées au cortège F.N.34
U.R. met en place une séparation fonctionnelle, employant le sigle G.U.D. pour les actions violentes et de celui d’U.D.E.N. (Union Des Etudiants Nationalistes) pour ses sections estudiantines officielles ; derrière cette stratégie semble pouvoir s’être dissimulée une volonté d’encadrer le G.U.D.-Paris au sein d’un mouvement comptant des sections provinciales moins animées de pulsions autonomistes. Lors du conseil national d’U.R. du 18 décembre 2002, la tension est manifeste, puisqu’il est précisé que l’appellation G.U.D. appartient à UR et que les velléités d’indépendance de sections du G.U.D. seront sanctionnées par leur dissolution35. In fine, le G.U.D. reprend sa liberté, est las du mégretisme d’U.R., « en a ras-le-keffieh des sionisteries des uns et surtout des autres, et décrète que ça a assez duré »36. En somme, U.R. prend une leçon de nationalisme-révolutionnaire de la part du G.U.D., qui en assène une autre dans le même élan à Guillaume Faye sur l’art d’appliquer le principe schmittien du politique et de procéder à une analyse sociologique… Lui pour qui Alexandre del Valle avait fait des conférences de formation, le désigne désormais comme un agent sioniste infiltré37. Le G.U.D. redisparaît et si certes des velléités existent de la faire renaître encore une fois, la page est bien tournée38.
Conclusion
Peut-on produire des conclusions politiques de l’histoire si chaotique de cette organisation ? La chose est délicate de par l’absence de continuité organique, militante, idéologique. L’absence absolue d’ordre et de doctrine très typique de l’extrême droite française est ici menée à son summum. Celle-ci même fait bien sûr sens, et il est patent que le G.U.D. peut-être vu comme un symptôme de la postmodernité. C’est ce qui fait son ambiguïté heuristique et le fait s’échapper aux analyses taxinomiques, ce qui n’est pas pour déplaire à un rat noir avide de défendre son individualité. Pour appréhender le G.U.D. l’un de ses responsables m’ exposait qu’il ne faut pas le voir « comme si c’était un parti politique sérieux avec son programme et son idéologie (…). Les Rats Noirs c’est juste une bande de potes motivée plus par l’action que par les idées exprimées en petit 1 et petit a. Le spectre idéologique des militants va facilement des royco bon teint aux NS plus NS que Degrelle, en passant par les tercéristes, cathos tradi, lepénistes, NR etc..»39. Le propos paraît fort juste et offrir plus de clefs pour comprendre le phénomène qu’effectivement la mise en classification politologique.
Mais ces convulsions sont aussi un fil d’Ariane pour comprendre les transformations du nationalisme. A chaque fois, l’ennemi que se choisit le G.U.D. est révélateur de sa décennie. Un de ses militants, par ses propos, illustre parfaitement également l’autre face de cette question : l’importance du regard antagoniste, lorsqu’il déclare : « à force de s’entendre traiter de nazillons par des gens que l’on hait ou que l’on méprise, on finit par se dire qu’au fond, après tout… »40. En somme, en politique, choisir ce que l’on hait est souvent le premier pas pour désigner ce que l’on est. Le fait que la gauche ait fait du G.U.D. un mythe explique bien plus sa survivance que les qualités d’organisation des gudards. Le problème du G.U.D. est de s’être survécu. Son mode d’action n’avait de sens que dans les années 1970, face à la violence gauchiste. Avoir survécu à son auto-dissolution revenait à jouer à la politique dans la caverne des ombres, et était juste promis à mobiliser un mythe. Cependant, tenir éveillés des mythes vitalistes au sein d’une ère matérialiste n’est-ce pas précisément ce à quoi aspirent les néo-fascistes ?
Notes
1 François Duprat , Le Néo-fascisme en France en 1973, Cahiers Européens, Supplément à la Revue d’Histoire du fascisme, septembre 1975, p.8 ; Christophe. Bourseiller, Les Maoïstes, Plon, Paris, 1996, p.117.
2Devenir, été 2000.
3Courroie de transmission post-68 du Service d’Action Civique dans les universités, puis du Rassemblement Pour la République, lié à la World Anti-Communist League, ce syndicat d’ultra-droite a bénéficié d’un financement du gouvernement étasunien (révélation faite dans Libération, 27 novembre 1985). .En 1986, puis en 1987 rejoint par le F.N.J, il a matraqué des étudiants de gauche de concert avec le G.U.D. (R. Griffin, « Net gains and G.U.D. reactions : patterns of prejudice in a neo-fascist groupuscule», 1999, p.36). En 2010, l’Union pour une Majorité Populaire a décidé de le dissoudre au sein d’un nouveau mouvement étudiant.
4 Rouge, 21 mars 1978. Le texte de l’organe de la Ligue Communiste Révolutionnaire parle de coordination étudiante. Etant donné ce mouvement, et ce front uni gudards-maoïstes, on peut se demander si ces derniers n’ont pas attaqué une de ces pseudo-coordinations noyautées par la L.C.R.
5Philippe Campinchi, Les Lambertistes, Balland, Paris, 2000, pp.182-183.
6 Le Matin, 17 décembre 1980 ; Les Rats maudits, pp.93-94 et J-G. Malliarakis, « Nanterre, symbole du système pourri », Jeune Nation solidariste, décembre 1980. Il semble en fait qu’il s’agisse bien d’une « descente » mais que les nationalistes soient mauvais joueurs et ne veuillent tout simplement pas reconnaître qu’ils ont perdu la bataille.
7 Le Quotidien de Paris, 22 août 1981
8 Les Rats maudits. Histoire des étudiants nationalistes 1965-1995, Editions des Monts d’Arrée, Paris, 1995, p. 97 et pp.106-108. Cet ouvrage est une autobiographie du mouvement réalisé par ses principaux cadres.
9Jeune Nation solidariste, octobre 1984.
10 Les Rats maudits, 1995, p.121.
11 Le Canard enchaîné, 25 janvier 1984.
12 Article 31, mai 1989 ; Jean-Yves Camus et René Monzat, Les Droites nationales et radicales en France, P.U.L., Lyon, 1992, p.15. L’adjectif « blanche » est une référence monarchique, non raciale.
13 Jeune Nation solidariste, juillet-août 1984. Durant ces manifestations, les nationalistes ont joué le rôle de troupes de choc de la droite.
14 Ludovic Piquemal, Groupuscules et mouvements d’extrême droite hors Front National dans les Pyrénées-Orientales 1984-2003, master d’histoire, Université de Perpignan, 2003, pp.46-48.
15 M.N.R. Bulletin de liaison, 23 février 1985 (document interne – qui nous paraît bien témoigner que la J.G. est l’affaire du M.N.R. et l’annonce de la fusion l’été précédent une tentative de forcer la main à un processus unitaire).
16Libération, 11 novembre 1985.
17 Compte-rendu du C.N. des 14-15 septembre 1985 (document interne).
18 G.U.D.-Jeune garde Infos, avril 1986 ; idem, juillet 1986 (documents internes). (L. Piquemal, 2003, pp.78-79).
19 M.N.R. Informations, 19 avril 1985 (document interne).
20 Informations NR, janvier 1986, note un foisonnement de groupes J.G. créés sur la base de départs du F.N.J : la perspective paraît bien celle de militants voulant rejoindre les champions du combat anti-gauches, non de personnes rejoignant un combat révolutionnaire (document interne).
21 TV Bulletin bimensuel d’information, 10 janvier 1987 (document interne).
22 S.G. .T.V, pochette de documents préparatoires au C.N. du 8 mai 1988 (documents internes).
23M.N.R. Bulletin de liaison, 12 décembre 1984 ; idem, 23 janvier 1985 (documents internes). La version allemande de J’avais un camarade était un chant fétiche de la Waffen S.S.
24Les Rats maudits, 1995, pp.117-125 ; Eric Rossi, Jeunesse française des années 80-90 : la tentation néo-fasciste, L.G.D.J., Paris, 1995, p.202). La scission est annoncée dans TV Inspection Régionale, 23 mai 1988 (document interne), qui tente de la minorer en la qualifiant de scission de la section d’Assas – mais Assas c’est le G.U.D.…
25 Rouge, 11 mars 1993.
26 Cf. Les Rats maudits, 1995, pp.129-131.
27Le soutien aux Croates des nationaux-catholiques est, comme celui de J-M. Le Pen, assis sur la dénonciation des « serbo-communistes », là où les NR placent leur soutien sous la bannière du socialisme croate. C’est, quelque soit le champ politique, un grand avantage des débats de politique étrangère : on y voit ce que l’on veut en voir.
28Eric Rossi, 1995, p.204 et 311 ; Le Monde, 2 décembre 1993 ; Bêtes et méchants. Petite histoire des jeunes fascistes français, Reflex, Paris, 2002, p.63. La radicalité du R.E. mène à ce que J-M. Le Pen vienne lui-même expliquer à son congrès de 1995 que le F.N. n’accepte pas les saluts nazis et autres folklores.
29Renaud Dély, Histoire Secrète du Front National, Grasset, Paris,1999, p.184.
30 Lutte du peuple, avril 1993.
31 La Lettre du Réseau, novembre-décembre 1998 (document interne).
32 Réflexions sur le développement d’UR, s.d (document interne).
33Jusqu’à Nouvel ordre, 1[5], 2002 .
34Jeune Résistance, printemps 2001.
35 « Motions administratives adoptées par le Conseil national de Bourges d’U.R. », La Lettre du Réseau, décembre 2001 (document interne).
36 Jusqu’à Nouvel ordre, n°1 [5], 2002. On voit l’évolution : c’est au nom de la fidélité NR (et de son autonomie sacrée) que le G.U.D. rompt avec U.R, ce qui inverse les anciens rapports. Le ton du journal reste très « gudard » mais il habille de ce style des dossiers de fond..
37Le G.U.D. évoque les conférences d’A. del Valle et G. Faye dans « Formation d’abord ! », Jusqu’à Nouvel ordre, hiver 1999-2000 – numéro où on trouve par ailleurs une interview de G. Faye à propos de la Colonisation de l’Europe : malgré la présentation dithyrambique, le jeu des questions-réponses ne cache pas que pour le G.U.D. l’ennemi reste le lobby juif américain, là où G. Faye explique que « pour moi, l’adversaire ce sont les Etats-Unis d’Amérique, intimement liés à l’Islam au plan mondial (…) on l’a vu au Kosovo avec la mise en place comme en Bosnie d’un Etat islamique en plein cœur de l’Europe. (…) Les USA sont des adversaires ; l’Islam et les peuples du Tiers-monde qui nous colonisent sont l’ennemi »). On note avec étonnement sur l’évolution du G.U.D. qu’il est un des rares à l’extrême droite à avoir produit un texte sur le Kosovo le resituant dans l’histoire de la Yougoslavie avant que d’exposer cette analyse (idem, automne 1999).
38Cf. cet article de l’excellent blog Droite(s) extrême(s).
39 E-mail d’un responsable du G.U.D., 2003.
40 Cité in Bernard Brigouleix, L’Extrême droite en France. Les « Fachos », Fayolle, Paris, 1977, p.188.